le 12 octobre 2012

Exercer l’art avec plus de justice sociale dans une société plus démocratique. Agir dans les venelles vers l’émancipation est le contraire de la financiarisation.
Le 1er août 2007, dans sa lettre de mission à Christine Albanel, ministre de la culture, le président Sarkozy
lui recommandait entre autres une démarche : veiller à ce que les crédits ministériels du spectacle vivant aillent bien à des œuvres correspondant aux demandes de la population.
Le nouveau président de la République engageait là une politique où « l’œuvre d’art est affaire du suffrage universel ». Cette question traverse l’histoire du théâtre et interdit, en tout cas mutile, une véritable politique de création artistique singulièrement de création théâtrale, démarche impliquant l’obsédante question du public.
Je souhaite évoquer une expérience vécue au delà de ce que disait Jean Vilar de la programmation du Festival d’Avignon qu’il avait créé en 1947 : « Je rêve de mettre en scène des œuvres théâtrales dont le public quand il les rencontrera ne sait pas encore qu’il va les aimer ».
Être ouvert aux voix et voies inconnues
Il y a quelques années, je suis saisi d’une demande d’un sculpteur de se voir prêter le temps d’une exposition une sculpture achetée par la ville d’Aubervilliers en 1947 au Salon d’automne. Maire d’Aubervilliers, je n’avais jamais vu cette œuvre, ni su même qu’elle existait. Le sculpteur m’envoie le document d’achat de son travail par la ville. Je me suis mis à chercher et après beaucoup d’interrogations d’habitants d’Aubervilliers à la Libération, j’ai retrouvé non pas la sculpture, mais sa mémoire et le sort qu’elle avait connu. Elle représentait « la maternité ». Mais la forme en était audacieusement nouvelle et le quartier où elle avait été installée devant une école maternelle ne l’accepta pas. Le traitement de la femme heurtait les habitants et le maire d’alors décida de la déposer dans un petit jardin intérieur d’un établissement scolaire où elle serait protégée, mais inaccessible à la vue. Le temps passa et l’œuvre fort belle, taillée dans un tissu de plomb, fut petit à petit abîmée par les intempéries, certaines soudures lâchant et différentes parties tombant sur le sol connurent le sort dramatique des ordures ménagères. Le regard hermétique au nouveau et sans tendresse devant des formes inconnues avait condamné la sculpture. Ce fut la mort d’une statue.
Lors de son prix Nobel, Saint-John Perse parla de la poésie comme d’un « luxe de l’inaccoutumance ». Jean-Luc Lagarce disait « une société, une cité, une civilisation qui renonce à sa part d’imprévu, à sa marge, à ses atermoiements, à ses hésitations, à sa désinvolture… est une société qui se contente d’elle-même ». Elle refuse l’inattendu, le nouveau, l’étrange, (ajoutez un « r » et ça fait étranger), elle s’immobilise, s’ossifie, perd sa fraîcheur, sa fragilité, son feu. « Dès qu’un art se fige il meurt » disait Jean Vilar en 1952, ajoutant en 1966 : « Le chemin du milieu est celui qui ne mène pas au festival d’Avignon ».
D’ailleurs en 1967, il réinventa le Festival d’Avignon, en rompant avec les programmes devenus habituels, en mêlant au théâtre la danse, le cinéma, le chant, la littérature, il appliqua avec audace cette idée d’Aragon « se souvenir de l’avenir ». Je me rappelle d’une de ses boutades expliquant son renoncement au TNP qui était son œuvre : « Les spectateurs en étaient arrivés à s’applaudir eux-mêmes ». Il y a là une règle d’or et il n’est pas d’époque où il ne faille se mettre debout et enrager pour défendre cette façon de voir : être ouvert aux voix et voies inconnues. « Provoquer, surprendre, réveiller, irriter même, liberté de création », telle était la pratique de Vilar. On est loin de « la culture comme œuvre de bonne volonté individuelle », « du consommateur roi », de « la culture unanimiste ».
C’est alors que Jean Vilar me chargea de réunir les responsables politiques élus par les collectivités et les artistes travaillant et créant dans les communes. Le débat eut lieu les 27 et 28 juillet 1967, il fut vif, il n’y eut pas de pensées molles, mais des pensées drues. C’était un affrontement entre le réalisme de nomenclature et le réalisme expérimental. C’était une illustration de la remarque d’Aragon : « Il n’a jamais suffi à l’art de montrer ce qu’on voit sans lui » et du propos d’Apollinaire : « Quand l’homme a voulu imiter la marche il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe ». En fait, la création qui est une vue, une réflexion, une transposition, une découverte de la réalité, est dans un premier temps reçue comme blasphémateur de cette réalité.
Et ce qui se passait en 1967 n’est pas effacé aujourd’hui. Il y a même aggravation à proportion de l’envahissement des programmes fabriqués par les industries culturelles marchant à la rentabilité, allant au nombre, fabriquant ce qu’on appelle « la culture de masse ». Aujourd’hui la vie artistique est agressée par ce phénomène que j’ai rencontré à l’état pur et naïf dans une ville du 93, Blanc-Mesnil, où quelques rares responsables de cette ville trouvaient que le théâtre local n’ayant pas plus de 50 % d’habitants de la ville dans sa fréquentation n’était pas justifié et qu’il fallait voir autrement. Au cours de la réunion pour examiner notamment cet argument, j’ai posé la question : « Combien avez-vous d’abstentionnistes aux élections dans votre ville ? ». Réponse : 50 % environ. Moi : « Alors vous avez décidé de supprimer le suffrage universel ? ». Un rire salvateur conclut cet épisode.
L’esprit des affaires l’emporte sur les affaires de l’esprit
Mais l’idée est tenace et revient sans cesse. Elle est renforcée par l’envahissement du marché dans le domaine culturel, par sa financiarisation et par des fatalités qui pour avoir une nuance comique sont très opératives : Le visiteur du soir de l’Élysée, Alain Minc, n’a-t-il pas dit : « Le marché est naturel comme la marée » ? Et Alain Madelin : « Les nouvelles technologies sont naturelles comme la gravitation universelle ». Or, le marché et les nouvelles technologies sont des inventions humaines pour s’en servir. En les chosifiant, leurs laudateurs les naturalisent et dans un même mouvement font de leurs inventeurs – des hommes et femmes – des êtres subsidiaires, des invités de raccrocs. C’est le monde à l’envers, c’est l’esprit des affaires l’emportant sur les affaires de l’esprit. C’est le « chiffrage » des « gestionnaires » culbutant le « déchiffrage » des « créateurs », c’est la financiarisation qui pénètre tout et impose son vocabulaire. Tout cela a des répercussions sur le travail des créateurs, des publics et au lieu de contribuer à les faire se rencontrer, les éloignent les uns des autres. Le travail dans ce domaine comme dans tous les autres est malade du management, ceux qui le font y respirent mal et voient prolonger cette mauvaise respiration dans le temps des loisirs rendant difficile la rencontre entre créations et publics. Il n’y a pas de perfusion culturelle à l’extérieur du travail malade.
On ne nous parle que d’utilité (avec l’espérance d’en faire de l’utilisable), que de compréhensible (après avoir abîmé la faculté d’étonnement, de penser, d’imaginer de chacune, chacun), que d’économie (sous direction du ciel bancaire et des jeux ténébreux du profit). On ne nous parle en fait que de médiocrité comme si c’était le destin obligé des hommes et des femmes alors que l’on devrait se parler et agir selon la belle expression du peintre chilien José Balmès : « en se compromettant avec la personne humaine ».
Travailler pour l’art et
sa rencontre avec les publics
C’est un travail inouï. Il ne faut pas avoir peur de dire, de faire, d’être affectueux, de considérer – surtout, dans ces temps de tourmente – que travailler pour l’art et sa rencontre avec les publics c’est faire des investissements de haute mer, des investissements humains et non cette incroyable consigne impérative, cette tyrannie rentabilisatrice extraite du rapport Jouyet-Levy sur « L’Immatériel » remis au ministre de l’économie en 2006 : « Il convient de traiter économiquement le capital humain ».
Pierre Soulage dit : « L’art donne forme à l’inachevé ». Pierre Reverdy écrit : « La science découvre et dévoile peu à peu ce qui est. L’art créé d’un seul coup, d’après ce qui est, ce qui n’était pas », Christa Wolf commente : « Le sentiment éprouvé dans l’expérience artistique nous permet d’imaginer ce que nous pourrions devenir ». Écoutez Aragon : « En entendant chanter Fougères, l’héroïne de La mise à mort, j’apprends, j’apprends à perte d’âme » et Foucault : « On écrit pour se déprendre de soi- même ».
Comment ne pas mêler ces voix de poètes à celles de scientifiques concernant l’homme, la femme, les publics. « L’homme est plein à chaque minute de possibilités non réalisées ». « Les hommes et les femmes peuvent se retrouver une tête au-dessus d’eux mêmes » (Vygotski), « La vie est habituellement en deçà de ses possibilités mais se montre au besoin supérieure à sa capacité escomptée » (Georges Canguilhem), « Au travail contrairement aux apparences on ne vit pas dans un contexte, on cherche à créer du contexte pour vivre » (Yves Clot).
Cette mêlée précieuse est un pouvoir d’agir dans les venelles vers l’émancipation, le contraire de la financiarisation. Elle me fait penser à ce garçonnet, à cette fillette qui apprennent apparemment si facilement à nommer leurs premiers jouets, train, wagon, locomotive avec leur papa, leur maman. Arrive l’école et l’écriture de ces mots. L’enfant est stupéfait que le train qui est long soit désigné par un mot court (5 lettres) et le locomotive qui est courte le soit par un mot long (10 lettres). L’institutrice qui me rapportait cette histoire ajoutait : « Mon travail est d’aider l’enfant à “accéder à l’arbitraire du signe” ».
Dans un rapport de 1987 : Projet pour le Théâtre de la Comédie de Genève écrit par Matthias Langhoff on lit ceci : « Un bon directeur de théâtre ne doit pas mettre ses efforts au service d’une prise de décision majoritaire et démocratique. Son travail tout comme son être doivent être animés par un tel esprit d’ouverture et de curiosité que les décisions qu’il sera appelé à prendre permettront à chaque individu de se développer et de s’épanouir au maximum […] L’art n’est pas démocratisable ; on pourra seulement l’exercer avec plus de justice sociale dans une société plus démocratique […] Les subventions ne sont pas là pour que le théâtre existe mais pour que la population puisse goûter au meilleur théâtre […] ». n
Extraits d’un entretien consacré à Jean Vilar publié dans l’Humanité, reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.
*Jack Ralite est ancien ministre (PCF) et
maire honoraire d’Aubervilliers. Il a fondé les États généraux de la culture.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 12 octobre 2012

Dans ces espaces s’exprime une des tendances fortes de l’art actuel, le désir de faire de l’œuvre un lieu de prédilection de la rencontre entre les hommes.
L’ appellation « nouveaux territoires de l’art » renvoie à des expériences qui ont un fonds commun. Mais ces trois mots, dont je me suis servi avec d’autres chercheurs et acteurs culturels pour nommer des lieux que nous estimions singuliers au regard des institutions existantes, ne sont pas une marque déposée. Qu’on leur préfère d’autres mots – fabriques, lieux alternatifs, espaces intermédiaires – peu importe, puisqu’il s’agit à chaque fois de donner à voir l’originalité et la pertinence d’actes artistiques cherchant à ouvrir des pistes jusqu’alors insuffisamment explorées.
Des expériences novatrices
Ces expériences ne sont pas sans passé. Les pionniers de la décentralisation théâtrale, je pense aux Dasté, Gignoux et autres, demeurent des défricheurs étonnamment jeunes ; c’est un peu cet état d’esprit, toutes proportions gardées, qu’on trouve dans ces nouveaux lieux qui se développent hors des institutions reconnues. Phénomène marginal ? Non. Car ce qui pousse des artistes, le plus souvent dans de jeunes structures ayant moins de comptes à rendre à des tutelles, à faire feu de tout bois pour s’adresser aux publics qu’on voit peu dans les circuits traditionnels, à transgresser les coupures entre disciplines, à explorer des voies neuves d’appropriation et de fonctionnement, devient un phénomène courant. C’est réjouissant et passionnant.
Il est primordial, dans un monde de plus en plus standardisé, de favoriser des espaces qui essaient « autre chose». Mon propos ne s’inscrit pas dans le sillage des procès faits aux scènes labellisées ou au spectacle vivant tel qu’il a été promu par le ministère de la Culture. Un travail gigantesque a été accompli là en un demi-siècle. Aucun autre pays n’a offert autant de résistances aux pressions du marché et le grand nombre d’artistes venus du monde entier pour en bénéficier est une preuve parmi d’autres de la pertinence dont nos politiques publiques ont fait preuve. Mais l’évolution de nos sociétés et le poids des idées libérales ont écorné le rêve d’une « démocratisation de la culture » par le haut et par l’offre qui devait ouvrir, pensait-on, sur un goût croissant de tous pour les créations artistiques les plus exigeantes. Nul n’a démérité mais des passions ont été asphyxiées ; les mouvements d’éducation populaire se sont étiolés.
Un besoin impératif de renouvellement s’est donc peu à peu imposé. Pas à la place de l’existant, mais à côté. C’est un des traits du paysage culturel actuel et c’est en cela que les nouveaux territoires sont un atout exceptionnel. Au cours de mon bref passage au ministère de la Culture, j’avais été interpellé par un écrit de Paul Virilio évoquant ces espaces intermédiaires comme « une sorte de cri pour retrouver la ville, le commun. » Le recensement opéré alors – rapport Lextrait – sur la densité de ces aventures atypiques fut pour moi une découverte. S’il est évident qu’existe parfois un décalage entre les réalités et les discours tenus, le grand intérêt de ces expériences est l’envie qui domine de bousculer la représentation du statut de l’artiste, de sa fonction sociale et des politiques culturelles pouvant en naître. Il existe là, sans que cela soit antagonique à d’autres approches, une des tendances fortes de l’art actuel, le désir de faire de l’œuvre un lieu de prédilection de la rencontre entre les hommes.
Les rapports avec les populations
Le choix qui y est fait de travailler sur plusieurs entrées, d’offrir une diversité d’ approches aux populations les plus circonspectes, de jouer sur les croisements entre disciplines, de penser davantage aux rapports avec les populations qu’en ciblage de publics, le choix de faire cohabiter sans tomber dans la confusion le travail artistique avec des activités sociales ou associatives, la volonté enfin sans céder en rien aux exigences de la création, d’écouter et de dialoguer dans un but d’appropriation de l’œuvre me semblent aller à l’essentiel des défis d’aujourd’hui.
Cette approche, qui est menée de manière plus ou moins convaincante selon les lieux, et qui n’est pas absente je le redis des préoccupations de certains de ceux qui oeuvrent au sein des institutions, est une des clés de la « démocratie culturelle ». Il est évident que les
inégalités frappent culturellement l’ensemble du champ social. C’est une plaie intolérable qui mine les rapports entre les individus. Celui qui n’a accès qu’aux show télévisés est diminué dans ses possibilités de penser, d’aimer et de résister. Mais il faut aussi admettre comme point de départ, à moins d’entériner les fossés existants, que chacun a ses représentations culturelles du monde, une sensibilité, des mots pour l’exprimer. On ne peut pas présupposer que les millions de gens qui ne vont ni dans les théâtres, ni dans les bibliothèques seraient incultes, aliénés à la marchandise, voués automatiquement à des stupidités télévisuelles.
Il est donc réconfortant de voir des artistes, et c’est une pratique dominante dans les nouveaux territoires de l’art, s’intéresser aux représentations culturelles que les gens ont d’eux-mêmes et des autres , aux configurations symboliques qui les font agir ou subir, aux pratiques culturelles qu’ils développent en propre. Nicolas Bourriaud, qui fut directeur du Palais de Tokyo à Paris, a développé une belle métaphore sur la « pluie culturelle » ; constatant que n’importe quel individu est aujourd’hui confronté à une véritable pluie d’objets culturels et de signes, tout projet, pense-t-il, qui veut s’adresser au plus grand nombre, doit s’efforcer, sans renoncement aucun, de ne pas balayer cette « pluie », de construire au contraire des rigoles, des dispositifs pour comprendre et capter les envies et s’en servir. C’est ainsi que des relations se nouent entre des publics nouveaux et des œuvres et que naissent des espaces de dialogue.
Ce désir de refaire avec d’autres la ville, de révolutionner les expériences de travail, offre la possibilité de dépasser une vision réductrice de la culture. La place de cette dernière dans la cité, dans la vie sociale, est désormais le cœur de l’évolution de nos sociétés ; c’est là un enjeu politique fondamental. L’intervention citoyenne a besoin d’échanges, de confrontations, d’un langage créatif et commun. L’ancien maire de Rennes, Edmond Hervé, qui comme président de l’Institut des Villes poursuivit après 2002 le travail pour sauver les territoires de l’art de l’étranglement financier que la droite leur infligeait, affirmait que ces innovations permettaient de réunir les conditions d’une interpellation transversale de l’économique, du social, de l’éducatif et de l’urbain. Les espaces pour inventer du commun, jeter des passerelles entre différentes formes d’expression, sont une exigence pour toute politique émancipatrice. Les nouveaux territoires de l’art sont de solides points d’appui pour relever ce défi. La droite au pouvoir n’en est pas venue à bout. Ces lieux de résistance aujourd’hui relèvent la tête et attendent avec raison les moyens de remplir leurs missions. n
*Michel Duffour a été secrétaire d'État PCF au Patrimoine et à la Décentralisation culturelle de 2000 à 2002.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 12 octobre 2012

Si nous l'avions oublié l'actualité se ferait fort de nous rappeler que l'opposition Capital/ Travail est toujours à l'œuvre, mais si derrière ce couple infernal, l'incidence économique est d'emblée reconnue, elle ne doit pas cacher que la question culturelle est bel et bien, elle aussi décisive.
L a reconnaissance de la culture au sein de l'entreprise fut longtemps contestée par le patronat, même si la création des comités d'entreprise en 1945 constitua une rupture décisive.
Pour autant les relations entre le monde de l'entreprise et celui de la culture ne furent pas un long fleuve tranquille, loin s'en faut, tant cette reconnaissance porta et porte toujours de rudes coups aux politiques de gestion patronale. Cette histoire pourrait se résumer en cinq phases.
La construction du syndicalisme
Première phase, c'est à l'aube des années 1850, au tout début de la grande industrialisation, que le patronat, afin de sédentariser une main-d'œuvre qu'il juge trop mobile, organise autour de l'entreprise une véritable toile d'araignée tentaculaire « les œuvres sociales patronales ». Le patron qui est aussi souvent le maire et le député, régente de « la naissance au cimetière » la vie des habitants : stade de foot, harmonie municipale, fanfare, caisse de solidarité, école professionnelle, hôpital, mutuelle… Tout est géré, organisé, subventionné et surtout contrôlé par le patron.
C'est contre cette mainmise paternaliste que va se construire le syndicalisme, et ceci n'est pas la moindre des exceptions culturelles françaises. Les premiers syndicats de métier vont très vite revendiquer la gestion des affaires qui les concernent en créant eux-mêmes leurs propres caisses de solidarité, leurs mutuelles, leurs clubs sportifs... En proposant au sein des universités populaires dès leurs premières années à la fin des années 1880, des cours d'économie politique, de philosophie, d'histoire, des ateliers d'arts plastiques, de théâtre, des conférences avec des intellectuels, des écrivains, des lectures collectives...
En 1895, année de sa création, la CGT, née de la fusion des Fédérations de métiers et de la Fédération nationale des Bourses du travail, trouve dans sa corbeille de naissance une riche tradition de gestions sociale et culturelle. Ce mouvement va encore s'amplifier jusqu'aux années 1936, des fédérations telle celle des métaux se dotent d'un solide patrimoine, sanatorium, centre de loisir, polyclinique, centrale d'achat, bibliothèques…
La victoire du Front populaire signe un retournement du rapport de forces tout en marquant la fin de cette première phase.
La création des comités d’entreprise
C'est dans la Résistance, dans le programme du CNR, puis à la Libération, que se construit la seconde phase. Les grandes nationalisations, la création de la Sécurité Sociale, des caisses vieillesse et retraites, puis celle des CE transfère enfin le pouvoir aux salariés...
Dans les entreprises les « œuvres sociales » sont « rétrocédées » à partir de 1945 aux comités d'entreprise. Ceux-ci vont s'employer en quelques années à substituer à la notion « d'œuvres sociales » celle « d'activités sociales et culturelles ». Derrière ce glissement sémantique se donne à lire une farouche volonté de s'affranchir des concepts d'assistanat, de caritarisme, de paternalisme, et de creuser une conception de la culture émancipatrice, héritière des « Lumières ». De la « Bataille du livre » au soutien de l'aventure du TNP de Jean Vilar, les CE innovent, construisent. Ils se dotent d'un patrimoine important dans le tourisme social, invitent des artistes et aident à la création de nombreuses œuvres artistiques. Mais les obstacles patronaux sont toujours nombreux, bibliothèque de Renault Billancourt déménagée en une nuit, il faudra attendre 1982 pour que le bibliobus du CE Peugeot Montbéliard puisse enfin pénétrer dans l'entreprise.
Introduction du concept « culture d’entreprise » et mécénat culturel
Une troisième phase s'inaugure à l'orée des années 80, le patronat tente de reprendre la main en déployant le concept de « culture d'entreprise ». Slogan qui cache, en fait, deux opérations de nature distincte, la première d'ordre idéologique a pour finalité la recherche d'un consensus au sein de l'entreprise, « nous sommes tous sur le même bateau », « nous devons ramer ensemble », « nous partageons les mêmes valeurs », « l'entreprise est une communauté culturelle ». Les syndicats ne seront pas dupes et cette opération idéologique sous couvert de caution culturelle fera long feu. La seconde, rendue possible par de nouvelles dispositions législatives, permet aux entreprises, en fait aux employeurs, de faire œuvre de « mécénat culturel » et de bénéficier en retour d'allégements fiscaux substantiels. Il va s'en dire qu'un certain nombre d'entreprises profiteront de cette ouverture sans que le comité d'entreprise, pourtant décisionnaire en la matière depuis la loi de 1946, ne soit consulté ni même informé. La Fondation Renault Art Industrie, par exemple qui rassemble la plus grande collection d'œuvres du peintre Vasarely n'a jamais fait l'objet d'une information devant le CE et n'a donc encore moins été présentée aux salariés de l'entreprise qui en sont pourtant en quelques sortes les copropriétaires.
La culture au travail
La quatrième phase s'ouvre dans les années 1990, lorsque la CGT met en avant le double concept de « la culture au travail ». Double parce qu'il s'agit tout à la fois de revendiquer et de faire reconnaître l'action culturelle menée par les CE et dans le même temps d'affirmer que le travail, en tant que tel, est en lui même producteur de culture. Ainsi l'entreprise est tout à la foi « réceptacle » de culture grâce à l'action culturelle mis en œuvre par les CE, tout en étant dans le même mouvement, un « foyer », un « creuset », de culture parce que le travail est lui même culture. Cette affirmation est au cœur des batailles syndicales d'hier et d'aujourd'hui.
En effet, le patronat a toujours tenté, et longtemps réussi, à déconnecter le travail de la culture, à extraire la culture du travail. Le Fordisme, le taylorisme, hier, la parcellisation des tâches, le télétravail, la précarisation des tâches, tout fut fait, tout est fait pour briser le collectif de travail.
Le combat pour tenter de faire reconnaître « le travail réel » et non le « travail prescrit » reste un combat culturel de premier ordre.
Le défi d’aujourd’hui
Nous entrons aujourd'hui dans une cinquième phase en forme de défi lancé aux comités d'entreprise, à savoir tenir les deux bouts de la culture « au » travail et de la culture « du » travail.
La tâche est rude pour les syndicats qui doivent se battre sur les deux fronts, d'une part, développer des activités sociales et culturelles émancipatrices qui se démarquent du consumérisme ambiant, qui se singularisent en suscitant la citoyenneté, la lucidité, en provoquant le pluralisme des idées, des images, des imaginaires, c'est à dire en agissant à « contre courant » des média et de la société de consommation, ce qui n'est pas tâche facile.
L'autre front, lui aussi est plus que décisif, il s'agit de la bataille pour le contenu, les conditions et l'exercice du travail. Il faut rendre celui-ci davantage qualifiant, davantage épanouissant ...Il n'y a pas de fatalité en la matière...
Les deux combats sont liés, et plus que jamais interdépendants, pas de loisirs et de pratiques culturelles épanouissants sans travail qualifiants. L'usage de ce temps que l'ont dit improprement « libre » est modelé, aspiré, hanté par la sphère du travail.
Aujourd’hui les CE sont doublement menacés, directement par les fermetures de sites, les délocalisations, les suppressions d'emplois et indirectement par eux-mêmes s'ils cèdent à la facilité, s'ils s'alignent sur les demandes consumérismes, ou redistribuent leur subventions en chèques lire, et autres chèques de tous ordres. Bref s'ils perdent leur singularité, leur spécificité, leurs raisons d'être, les CE sont aussi menacés par eux-mêmes.
C'est donc un double combat qu'ils doivent mener, celui pour la bataille de l'emploi, de son contenu, de sa qualité, de sa « plus-value » sociale et culturelle. L'autre combat concerne la qualité et la singularité des activités sociales et culturelles qui doivent être, devenir, ou redevenir, des activités au service de l'épanouissement des salariés, des outils au service d'une pleine et riche citoyenneté.
Le dialogue culturel dans l'entreprise c'est le dialogue, le métissage entre ces deux réalités culturelles. Le patronat l'a bien compris qui cherche à faire entrave au bon fonctionnement du CE (la très grande majorité des CE perçoit beaucoup moins de 1% de la masse salariale) et qui fait pression pour « déculturer » cette expérience majeure qu'est le travail. Ceux qui aujourd'hui, se gaussent ou caricaturent l'action des comités d'entreprise, seraient bien inspirés d'aller voir ce qui se passe dans le travail, car quand le travail est malmené la culture toujours en souffre.
*Jean-Michel Leterrier est syndicaliste et essayiste.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 12 octobre 2012

Comment prendre en compte l’art et la culture dans les politiques territoriales, réinterroger le rapport droit commun/droit spécifique, repenser les morphologies et les périmètres des géographies prioritaires.
L ors de cette dernière élection présidentielle, un vif débat avait animé le Front de gauche sur la question de la politique de la Ville. Il y avait ceux qui prônaient la disparition du ministère de la politique de la Ville au nom de l’universalité du traitement social des citoyens et il y avait ceux qui prônaient la prise en compte des identités sociales et spatiales et culturelles dans leurs rapports à la ville. Mais tous avaient pour objectif une politique qui « pense le changement au lieu de changer le pansement ». Le projet d’une VIe République venait englober cette finalité en posant la question de l’horizontalité de l’intervention de l’État qui permettrait aux citoyens de « prendre le pouvoir » sur leur parcours de vie. Une part non négligeable de ce débat concernait les politiques culturelles : Démocratie ? Démocratisation ? Il s’agit, historiquement, d’une prise en compte de l’art et de la culture dans les politiques territoriales. L’action culturelle fut progressivement mobilisée par l’action publique au côté des droits fondamentaux (emploi, logement, santé, éducation, mobilité) pour veiller à l’égalité qui fonde notre République.
Les géographies prioritaires rendent certes visibles bien plus qu'ailleurs les situations d'exclusion et de précarité sociale et culturelle, mais celles-ci ne représentent qu'une partie de l’iceberg. De plus, nous sommes dans une phase où la logique structurelle de l'intervention publique change. L’Europe de l’austérité rend les acquis sociaux de plus en plus vulnérables et opère un décrochage social durable. Parallèlement, avec les réformes territoriales, l’effort est centré non pas sur la réduction de l'écart entre des quartiers prioritaires et le reste de la ville, mais sur l’interconnexion des centralités entre elles. C'est un « nouvel ordre » dans l'organisation de l'espace urbain qui s’opère : conception discontinue des territoires, mise en réseau des élites et des technopoles, spécialisation fonctionnelle des territoires, interdépendance sélective. Nous sommes à l’ère métropolitaine.
Compétence en matière de culture des pôles métropolitains
Selon le titre d’un colloque organisé par l’association des maires des grandes villes de France, les métropoles sont au « tournant des politiques culturelles ».
Dans les statuts des pôles métropolitains officiellement arrêtés au 1er juin 2012, la culture fait partie des compétences énumérées par l’article 20 de la loi RCT du 10 décembre 2010 puisqu’il s’agit de coopération intercommunale « en vue d’actions d'intérêt métropolitain en matière de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture ». Il apparaît aussi dans les rapports communautaires, la volonté de faire émerger le sentiment d’appartenance métropolitain. Ainsi, le modèle métropolitain inspire, pendant que le modèle européen expire mais le modèle de « la concurrence libre et non faussée » reste le même.
Les politiques culturelles engagées sur un territoire en processus de métropolisation ont l’obligation d’être structurantes. Elles se trouvent face à un double enjeu : celui de la cohérence avec d’autres stratégies publiques, et celui du déploiement des projets culturels pour des territoires plus étendus et plus hétéroclites.
Pourtant cette nouvelle compétence est quasiment occultée du débat démocratique actuel sur les métropoles. Plus exactement, le monde culturel est mis devant le fait accompli puisque cette compétence est confinée dans une approche utilitariste, dépendante du développement économique, inscrite dans les « pôles de compétitivité », liée à l’attractivité financière et touristique des grandes villes, déclinée dans les industries créatives au côté de la mode et du design. La promotion des activités culturelles aurait donc pour but
d’attirer les investissements économiques, l’implantation d’entreprises, l’attraction touristique et le renouvellement de sa population. Quelles classes sociales attire-t-on ainsi ? dans quelles conditions s’insèrent-elles localement ?
À l’évidence, la métropolisation des politiques culturelles engage le changement d’échelle qui réinterroge le rôle des équipements et manifestations d’intérêt métropolitain. Elle vise à mutualiser les coûts, à réguler les concurrences internes d’une part et se mettre en concurrence avec ceux des autres métropoles nationales, européennes et internationales d’autre part. Ainsi, le transfert des grands équipements à l’échelon métropolitain pose des questions fondamentales : quelles mises en réseau pour quelles dynamiques culturelles structurantes ? pour quelle identité des territoires ? Est-il envisagé des coopérations entre centralités et périphéries ? Quelle conception de la proximité ? Quelle serait la valeur ajoutée du modèle métropolitain ?
Au plan local, les politiques culturelles doivent appréhender ce nouvel échelon puisqu’il nous conduit à réinterroger le rapport droit commun/droit spécifique, et, par là, à repenser les morphologies et les périmètres des géographies prioritaires.
L’ensemble de ces projections nous oblige à penser l’art autant par le prisme de la complexité sociale et spatiale de cette nouvelle configuration en marche, qu'en termes culturel et financier.
Nous devons, donc, aller au-delà du « mythe fondateur » de ce nouveau territoire promis : mener une politique culturelle c’est se donner les moyens de prendre connaissance des enjeux et anticiper sur les nouvelles politiques culturelles des grandes villes régionales, du quartier à la métropole, en posant la question précise de ce que pourra être l'aide à l’expérimentation, à la création, à la diffusion, qu’il s’agisse de professionnels ou d’amateurs.
Si la gauche partage le postulat que l’art se pense à la fois dans sa relation avec la société qui le produit et dans les relations sociales qui se jouent à travers lui, le réduire à un instrument de pouvoir ou le limiter à « l’accès à l’art » (faisant fi de l'influence de la société sur son expression) serait fatalement destructeur voire autocratique. Alors, il devient urgent d’identifier démocratiquement les enjeux culturels contemporains et de verser au débat politique les finalités et les garde-fous de ce processus de métropolisation de l’intervention artistique dans la « Métro-Cité ». n
*Nawel BAB-HAMED, est conseillère municipale (PCF) déléguée à la culture de la mairie du 1er arrondissement de Lyon.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 12 octobre 2012

L’intermittence en soi ne saurait suffire à déterminer un « statut ». Elle n’est qu’une adaptation d’un mode particulier d’exercice du travail à la situation générale.
Nous avons tous rencontré un jour un enfant qui nous a dit : « Quand je serai grand, je serai comédien ! ». Ou danseur, ou pianiste, ou même ingénieur du son ou costumier(e). Je n’en ai pas encore rencontré qui m’ait dit : « Quand je serai grand, je serai intermittent ! ».
Pourtant, et notamment depuis une dizaine d’années et le conflit de 2003 consécutif à la « réforme » des annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC et la signature d’un nouveau protocole entre le patronat et les organisations syndicales de salariés, les luttes intenses de l’été 2003 ont fait entrer le mot dans la langue, sans autre précision. L’intermittent est devenu la figure obligée du travailleur du spectacle. Si bien qu’il n’est pas rare, y compris chez les intéressés eux-mêmes, d’entendre parler du « statut d’intermittent » : « Je viens enfin d’obtenir mon statut… », formule qui signifie que le salarié a enfin réussi à travailler suffisamment longtemps pour entrer dans le système, et y demeurer. On entend plus rarement dire : « J’ai enfin obtenu mon statut de précaire »…
Le terme est devenu comme un référent identitaire, en quelque sorte en creux. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de voir ce régime spécifique d’assurance-chômage tenir lieu de « carte d’identité professionnelle » à ses bénéficiaires ! Un genre de « statut de l’artiste » par défaut en quelque sorte.
Il y a au moins deux grandes familles d’artistes : les interprètes et les auteurs. Les premiers sont comédiens, danseurs, musiciens instrumentistes, artistes de variétés… Les seconds sont écrivains, compositeurs, plasticiens… Ils sont auteurs. On les qualifie souvent de « créateurs ». Nul ne conteste que les uns et les autres soient des travailleurs, désireux de vivre de leur métier, de gagner correctement leur vie, de bénéficier d’une couverture sociale décente. Il n’en reste pas moins que nous avons affaire à deux statuts très différents : le statut de salarié et le statut d’auteur.
Toutes les batailles des travailleurs du spectacle, depuis des décennies, visent à ce que leurs droits sociaux soient les mêmes que ceux des autres travailleurs, ou qu’ils y tendent, qu’il s’agisse du droit à un contrat de travail, à une protection sociale digne, à une formation professionnelle continue, à des congés payés… bref, à des droits communs à ceux des autres salariés. L’intermittence en soi ne saurait suffire à déterminer un « statut ». Elle n’est qu’une adaptation d’un mode particulier d’exercice du travail à la situation générale.
Blocages et impasses de l’intermittence
Pierre-Michel Menger dans son dernier ouvrage (Les intermittents du spectacle, sociologie du travail flexible), nous donne les derniers chiffres disponibles : en 1992, les « intermittents » étaient 61 583. En 2007 ils étaient 137 307 (soit 223 %). Pendant ce temps le volume de travail mesuré en milliers d’équivalents-jours, est passé de 4 947 à 9 157 (soit 185 %) : le volume d’emploi croît beaucoup plus lentement que le nombre de travailleurs concernés. Un autre chiffre est encore plus paradoxal : le nombre des contrats de travail, dans cette même période, croît de… 460 % ! Comment interpréter cela ? Plusieurs raisons :
• Un nombre croissant de jeunes gens souhaite exercer un métier artistique. On peut s’en réjouir. Mais l’offre de travail ne suit pas. Ces activités sont étroitement tributaires de l’intervention publique. Or, à part la réelle progression des budgets culturels des collectivités, progression qui elle-même se ralentit brutalement, les budgets culturels stagnent.
• Les employeurs, profitant de l’aubaine du CDD d’usage, en profitent pour morceler à l’infini, à des fins d’ « optimisation » des plannings, les contrats de travail, d’où la croissance exponentielle de ces derniers.
• La « permittence » n’a pas été jugulée. Qu’est-ce donc ? Il suffit de déclarer comme « intermittents » des salariés travaillant
à l’année, à temps plein, chez un employeur unique. En effet pourquoi salarier quelqu’un 7 jours sur 7 si l’ASSEDIC peut en prendre en charge 4 ? C’est cynique ? Oui. C’est possible, sinon permis. On trouve ça partout, y compris chez les sociétés de l’audiovisuel public, les centres dramatiques nationaux, voire certains théâtres de villes même communistes.
La résorption de cette crise chronique est un casse-tête dont personne ne voit la sortie. Il est pourtant rapidement possible, au prix de quelques mesures réglementaires simples, de corriger ces dérives. On peut interdire l’usage du régime des annexes 8 et 10 pour certaines fonctions par essence permanentes. On peut aussi pénaliser de façon dissuasive les entreprises qui abusent du système, par exemple en jouant sur les taux de cotisations (un genre de bonus-malus), ou sur les subventions publiques. Il suffit d’un peu de volonté politique.
Enfin, on ne sortira pas durablement des « crises » qui affectent le régime de l’intermittence en se bornant à résorber des abus, resserrer encore le champ d’application ou réduire les prestations. Nul n’ignore que la consolidation du régime, depuis 1983 et ensuite, a concouru à faciliter l’entrée dans les professions du spectacle de nombre de jeunes professionnels, a permis à des centaines d’équipes artistiques, notamment dans le spectacle vivant, de se professionnaliser, et a par conséquent mis sur le marché du travail des milliers de jeunes artistes et techniciens. On ne saurait contester une telle dynamique, qui a correspondu à une période d’accroissement important des budgets culturels de l’État, puis des collectivités territoriales. Aujourd’hui la part de l’intervention publique (État, toutes administrations et collectivités territoriales, tous niveaux confondus) est d’environ 14 Md€, soit moins de 0,7 % du PIB, quand la dépense culturelle totale (pouvoirs publics, entreprises et particuliers) est de l’ordre de 80 Md€, soit 4 % du PIB environ. Notons au passage que la plupart de ces nouveaux emplois, avec la complicité des tutelles, ont largement profité de l’effet d’aubaine des annexes 8 & 10, et fort peu à l’emploi durable. Un directeur de CDN me racontait, alors qu’il procédait à la création d’un atelier de construction de décors pour son théâtre, et créait dans un premier temps deux emplois permanents de techniciens qualifiés, qu’il s’était fait tirer les oreilles par la DRAC (direction régionale de l’action culturelle) au prétexte qu’il aurait pu recourir à l’intermittence…
Quelles solutions ?
On ne réformera pas durablement l’intermittence si on ne revisite pas à fond les conditions d’exercice des métiers. On ne peut plus longtemps supporter que l’augmentation du volume de travail, réelle ces trente dernières années, se traduise par une augmentation plus grande encore du chômage et de la précarité. Il est inacceptable que l’intermittence, mode d’exercice inévitable, quoique non exclusif, des professions du spectacle, soit devenue une absence de choix.
Le « non-travail » d’un artiste interprète ou d’un collaborateur de création, technicien ou autre, n’est pas une période d’inactivité. Le danseur poursuivra l’entretien de son corps, plusieurs heures par jour ; le pianiste continuera à faire ses gammes ; le metteur en scène mettra à profit cette période de calme pour lire des textes ou réfléchir à son prochain projet ; l’éclairagiste, le machiniste ou le technicien du son se formera, visitera les salons professionnels, testera les nouveaux matériels ; etc. Le « chômage » des travailleurs du spectacle est le plus souvent une période d’intense activité. On estime que le « nouveau protocole » de 2003 a provoqué l’éviction du métier de plus de 20 000 professionnels par an, parmi les plus fragiles, même si le choc a fini par se lisser à la longue. Qui peut oser dire que c’est un « progrès » ?
Après avoir analysé les blocages et les impasses du système, force est de constater qu’on n’en sortira qu’en créant de l’emploi permanent. Dans l’audiovisuel, la résorption de la précarité devra porter sur tous les métiers qui n’ont aucune vocation à être « intermittents », et dans le spectacle vivant on développera les politiques dites de « permanence artistique ». Cela passe par un accompagnement suivi des pouvoirs publics, y compris financièrement. Si les études sur les « Pratiques culturelles des Français » de ces dernières décennies font apparaître une relative stagnation des publics, notamment du spectacle vivant, il est clair que les expériences de « permanence artistique » se sont toutes traduites par un élargissement durable des publics et créatrices d’emploi. Reste à consolider ces créations d’emploi en les rendant en grande partie pérennes. Exemple quasi-unique en France : le TNP de Villeurbanne, où Christian Schiaretti, poursuivant l’expérience engagée lorsqu’il était directeur de la Comédie de Reims, a reconstitué une troupe permanente, aujourd’hui composée de 14 artistes. Quelques Centres dramatiques et chorégraphiques commencent timidement à s’engager sur ce chemin.
Le seul gisement d’économies en matière d’intermittence est dans la création d’emplois permanents. Développer une politique audacieuse d’emploi permanent, artistique et technique, dans le spectacle, des milliers d’artistes et de techniciens sortiront par le haut du système, verront leur emploi consolidé, leur travail pérennisé et leur fonction sociale confortée. Les citoyens-spectateurs, actuels ou potentiels, verront les équipes artistiques de leur territoire en situation d’assumer leur fonction de « laboratoire du symbolique » et de « partage du sensible » au service de l’ensemble du peuple.
*Jean-Jacques Barey est opérateur culturel. Il est co-animateur du collectif Culture du PCF.
le 12 octobre 2012

Nicolas Dutent : À regarder vos films, on constate un désir insistant de goûter au portrait sociologique. Le cinéma vous permet-il de prolonger votre ambition et votre curiosité universitaires ?
Robert Guédiguian : Oui. De même que j’ai étudié les sciences économiques, la sociologie, un peu l’histoire… je me suis engagé en politique. Pour moi, c’est une manière de vivre, c’est une manière de m’interroger sur le réel, m’interroger sur moi aussi. Donc c’est évident que au moment où j’ai basculé par une espèce de hasard objectif dans le cinéma je suis resté le même homme : je suis resté sur les mêmes désirs, les mêmes motivations, les mêmes curiosités. C’est pour moi une évidence absolue : faire du cinéma, c’est ma manière de vivre. Ma manière a toujours été une manière curieuse, très tournée vers les autres, cherchant à expliquer le monde, autant qu’on le peut [...].
ND : En dehors des canaux traditionnels de la politique, qu’est-ce que le cinéma en tant que tel a pu vous offrir de plus, de complémentaire ou de tout aussi déterminant pour saisir le monde ?
RG : D’abord, étrangement, c’est une parole qui est plus écoutée parce qu’elle est plus libre. Elle ne contient pas au sens strict du terme un seul message, ce que peut faire un tract – et il peut y avoir de très beaux tracts. Les tracts, a priori, ne relèvent pas de l’expression artistique : ils vont droit au but, il faut un slogan à la fin, un mot d’ordre, un message très précis, etc. Le cinéma est plus large et plus complexe que ça et il est plus écouté parce que, plus complexe, il est perçu comme plus libre. De ce fait, ça a une force de frappe extrêmement puissante. Des millions de gens voient un film. Ils peuvent y apprendre à s’interroger ou à voir le monde différemment parce qu’on le leur a présenté à travers quelque chose qui est de l’ordre de la sensualité. C’est une connaissance différente et j’allais dire qui nous remue, qui nous travaille, qui part d’une émotion. L’étymologie d’émotion, c’est mouvement. [...]
Guillaume Quashie-Vauclin : Lénine dit du cinéma que c’est l’art des masses, un art à investir à des finalités politiques parce que, même comparé aux autres arts, il a une force de frappe populaire plus forte. Mais est-ce que tout le monde va voir Guédiguian ?
RG : C’est une question importante. Un peu taboue. J’ai toujours mis les pieds dans le plat pour ces questions-là. Je continue de me poser la question : comment faire pour que le public vienne voir mes films ? On ne peut pas intervenir sans se poser la question : à qui on parle ? à combien de gens on parle ? Dès lors, il faut se donner des moyens, y compris des moyens qui peuvent être internes à l’œuvre pour y arriver. Mais évidemment ça apparaît à tous les artistes échevelés comme hérésie : « L’art ne doit s’occuper de rien d’autre que de lui-même. » Je n’ai jamais pensé cela et je continue de faire des efforts. Mais alors des efforts sans concession.
Il faut faire des efforts mais il faut que le public en fasse aussi. Il faut que le public ait envie d’être réveillé, d’être secoué : on ne peut pas réveiller quelqu’un qui veut absolument continuer à dormir. Je prends le public pour un public adulte. Je considère qu’il peut tout entendre, qu’il peut tout regarder. Je veux bien faire un effort pour parler dans sa langue, pour me rapprocher de sa langue à lui, pour qu’il n’ait pas à me traduire, pour qu’il n’ait pas besoin d’intermédiaire. Pour ça, il y a différentes méthodes : j’ai toujours fait par exemple du cinéma qui contient une trame narrative lisible au premier degré. Ça, ça me semble le B-A-BA pour qu’un film soit public.
Il faut qu’il y ait une lecture au premier degré : un type qu’on présente, il lui arrive ça, ça, ça et ça. Il passe du bonheur au malheur ou du malheur au bonheur… Il faut une intrigue et un dénouement. On finit bien si c’est une comédie ; on finit mal si c’est une tragédie. Ce sont les règles du récit depuis la nuit des temps ! [...] Il y a des films sans récit que j’aime beaucoup ; mais moi je n’en ferai jamais parce que j’aurai trop peur que les gens aient trop de difficulté à m’entendre. [...]
ND : De quelle manière vous avez perçu Marius et Jeannette, moment de bascule à partir duquel une partie des critiques et du public vous ont découvert ?
RG : Il y avait comme une espèce de stratégie de conquête du public depuis quelques années. Je devais le penser inconsciemment avant de le faire. J’ai toujours voulu faire des films que mon père puisse regarder. C’est une formule commode mais mon père était ouvrier, en réparation navale sur les quais à Marseille : je pense qu’il a compris chacun de mes films. Je ne pense pas, j’en suis sûr. Ça, je le faisais consciemment. Mais à partir de L’Argent fait le bonheur, après Dieu vomit les tièdes d’ailleurs, et avec À la vie à la mort, je préparais le terrain pour Marius. Inconsciemment bien sûr. L’Argent fait le bonheur a très bien fonctionné. C’était un conte : il tordait le réel dans le bon sens.
Ce qu’on allait voir n’était pas tout à fait vrai, quoique plausible. C’était possible mais j’ai précisé que c’était un petit peu trop optimiste… À la vie à la mort a aussi été un grand succès critique. Les gens qui sont allés voir Marius attendaient la suite de ces deux films-là. Et c’est arrivé. Je ne savais pas bien sûr : je ne pouvais pas deviner que ça allait être un tel succès. Après, c’est le film lui-même, l’époque, l’histoire… Après, j’y peux plus rien. Mais la stratégie de conquête du pouvoir à travers la farce, la comédie, le conte, choses qui ont à voir avec Brecht d’ailleurs, avec la puissance des choses théâtrales, la musique à l’intérieur du film : c’est quelque chose de très volontaire. C’est-à-dire : il faut que les gens entendent cette parole-là.
GQV : Le héros positif. N’est-ce pas un aspect original de votre travail, notamment dans le cinéma contemporain qui se méfie de telles figures ?
RG : Je pense qu’il est effectivement intéressant de montrer des héros positifs.[...]Je crois que le cinéma doit aussi permettre de montrer des gens auxquels nous pouvons nous identifier. Ce qui est d’ailleurs la clé du succès public. Je ne suis pas là pour montrer seulement le monde tel qu’il ne va pas, déraisonne. Nous pouvons montrer en même temps en quoi il peut être source de réjouissance, comme il résiste et met en évidence des comportements quelquefois exemplaires. Dans L’Armée du Crime, les protagonistes sont bien entendu morts trop tôt et trop jeunes pour être mauvais ou jetés dans les compromis, ils ont accompli leurs vies. Toutes les lettres qu’ils écrivent avant de mourir sont d’ailleurs remplies de joie… Ils étaient à la fois forts et fous. Et sans vexer personne, notamment les descendants, je crois qu’on peut dire qu’ils ont pensé avoir « bien vécu » même s’ils ont vécus « court ». Ce sont en quelque sorte des « héros » au sens grec du terme, ils n’ont d’ailleurs pas souffert des affres de la vieillesse, ils sont morts jeunes, le corps intact… Mais ils n’en demeurent pas moins des sortes de héros positifs auxquels nous pouvons nous identifier (ce ne sont pas des gens « sans taches »). Ça existe et je ne vois pas pourquoi on ne le montrerait pas. Je suis toujours effaré par la manière dont la critique considère que tout ce qui est tragique, grave etc. l’emporte systématiquement sur la comédie. [...]
ND : Quelle place accordez-vous au spectre de votre enfance, votre éducation, vos lectures, votre apprentissage artistique… dans ce dont sont « faits » vos films ?
RG : Il y a déjà l’école. Mais la religion aussi. Je suis depuis longtemps athée, mais j’ai fait ma communion, suivi des cours de catéchisme. Ma mère est issue de Rhénanie, la seule région catholique d’Allemagne. Cet enseignement m’a au départ impressionné. L’approche du texte a été fondamentale : comme le dit Pasolini, les Évangiles sont un des plus beaux textes jamais écrits. Ce texte est remarquable même si je l’aborde personnellement comme une fiction. Mon premier rapport aux formes artistiques a été celui-ci. Les vitraux de la plus petite église du monde, celle de l’Estaque, étaient une expérience elle aussi incroyable. La lumière, les peintures, l’orgue, la musique… tout cela y participait également.
Ensuite il y a eu la rencontre décisive avec le père de Gérard Meylan, mon ami d’enfance. C’était un instituteur communiste, « le maître d’école ». J’aime d’ailleurs cette expression. Il était, comme beaucoup à l’époque, d’une érudition sans bornes. [...] Il avait réponse à tout. [...] Il était insomniaque et lisait un roman tous les jours. Ajouté à quoi il était un fin connaisseur de musique classique. Il me prêtait des vinyles, les symphonies de Beethoven… Cette rencontre a évidemment joué un rôle. Le Parti communiste de cette époque joue un rôle formidable, voire indispensable, d’éducation populaire. Les almanachs de l’Humanité de ces années me laissent aussi un émouvant souvenir, cela a touché toute une génération. Je suis ensuite allé chercher, vers l’âge de 15 ans et après, Pasolini, Fassbinder… et parce que je savais que leurs préoccupations résonnaient avec les miennes. Il y a eu donc tout cela et le fait que la religion, en tant que forme, m’intéresse depuis toujours. Elle est une source de production artistique immense, une des plus connues et usitées du reste.
GQV : La question du rapport à soi, de la fidélité à soi, est elle aussi très insistante chez vous…
RG : La fidélité à soi-même est c’est vrai une hygiène intellectuelle intéressante, même importante. S’interroger sans arrêt sur ce qu’on est et ce qu’on fait de soi, permet de vérifier – par delà les adaptations nécessaires, on ne pense pas nécessairement ou scrupuleusement la même chose à 20 ans et 40 ans, il faut considérer que des évolutions sont possibles et parfois souhaitables, on peut penser à 40 ans les mêmes choses qu’à 20 ans mais adaptées à aujourd’hui, au contexte – ce qui est passé entre les mailles du filet. Cet examen autocritique est indispensable, sain. C’est une belle chose qui peut nous permettre de considérer qu’on s’est éventuellement trompé à certains moments. Il n’y a rien dans cela de mortifère, cela peut même revêtir un aspect pétillant, cet examen donne de la vitalité. C’est ce que j’aime chez mes deux personnages principaux des Neiges du kilimandjaro… Au fond, ils se disent « on a été justes, mais peut-être aurait-on pu l’être encore un peu plus ». Cela peut d’ailleurs, et même souvent, interpeller le spectateur lui-même sur ce que ce sont devenus ses vieux rêves. [...] n
*Robert Guédiguian est cinéaste.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 12 octobre 2012

Après plusieurs mois de discussions infructueuses, la Ville de Paris vient d’annoncer brutalement la fin des subventions municipales au Théâtre Paris-Villette.[...]
À bien des égards, ce lieu est unique à Paris. Mais ce qui lui arrive s’inscrit dans un contexte, malheureusement préoccupant [...]
Dans tous les cas, la responsabilité de l’État et de la Ville est conjointe. À chaque fois, l’argument budgétaire invoqué est particulièrement dérisoire en regard des moyens dont dispose Paris, qui de toutes les grandes villes de France est celle qui consacre la plus petite part de son budget aux arts et à la culture [...]
Le Parti communiste français exprime son plus entier soutien à toute l’équipe du Paris-Villette comme aux artistes de cette saison, qui ont unanimement décidé d’assurer la programmation du théâtre sans certitude d’être rémunérés pour leur travail.[...]
Il exige que la Mairie de Paris garantisse dans un premier temps le financement de la programmation et du fonctionnement de la saison 2012-2013. Avec les élus au Conseil de Paris du PCF et du PG, il invite l’ensemble des groupes de la majorité municipale à se ressaisir et à redonner au Théâtre Paris-Villette les garanties de pérennité dont il a besoin, simplement pour vivre.
le 11 octobre 2012

Aujourd’hui la nouvelle colonisation des esprits passe par l’extension du langage de l’économie, de ses valeurs, de sa fonctionnalité, de ses caractères quasi anonymes, abstraits et sans expressivité, pour abolir les particularismes culturels des classes sociales et nier chaque subjectivité.
L’ humain se transforme en « capital » que l’on doit exploiter comme « ressources », et auquel on apprend à « gérer » ses émotions, son deuil, ses « habiletés sociales », ses « compétences cognitives », au prétexte d’accroître ses « performances » et sa « compétitivité ». La vie devient un champ de courses
avec ses « handicaps », ses départs, ses « deuxièmes chances » et son arrivée.
Au point que la notion d’handicap tend à envahir tous les champs : celui de l’école, de la psychiatrie, de la psychologie, de la médecine, du travail social, de l’économie, de la sociologie… Mais d’où vient ce mot ? Le terme provient de l’anglais hand in cap, « la main dans le chapeau », primitivement jeu de hasard appliqué ensuite aux courses de chevaux au XVIIIe siècle. Le terme « handicap » a été introduit en français « avec l’idée d’égaliser les chances des concurrents en imposant aux meilleurs de porter un poids plus grand ou de parcourir une distance plus longue. Par extension, le terme […] se dit de tout désavantage imposé dans une épreuve à un concurrent de qualité supérieure. De là vient […] le sens figuré d’“entrave, gêne”, “infériorité” […] » Le participe passé du verbe « handicaper », d’abord dans le domaine hippique et ensuite dans le champ social désigne une personne désavantagée, et notamment une personne désavantagée par une déficience physique ou mentale. C’est un concept très intimement lié à l’esprit de compétition établissant l’idée de jugement comparatif de la valeur des objets, des chevaux puis des personnes. Définir la souffrance d’un individu à la lumière de ses chances à concourir dans le champ social participe d’une civilisation sportivo-managériale des mœurs. L’extension aujourd’hui du terme, « handicap », se révèle comme un symptôme de la maladie de notre civilisation et des formes de savoir qu’elle produit.
Savoir, pouvoir et pratiques sociales
Les formes du savoir à une époque donnée et dans une société donnée sont inséparables des formes de pouvoir, des pratiques sociales en œuvre à ce moment-là. Cela ne veut pas dire bien évidemment que les découvertes scientifiques soient de pures constructions sociales – conception aussi absurde que dangereuse – mais que la culture, dont elles émergent, favorise ou inhibe leur apparition et leur développement. L’historien de la médecine, Henry Sigerist, montre que la découverte de la physiologie de la circulation par Harvey est inséparable de l’histoire intellectuelle de l’Europe au début du XVIIe siècle, de l’épanouissement du baroque, qui donne à la science médicale ce point de vue perspectiviste ouvert à l’illimité et l’infini qui permet de passer du modèle anatomique à l’idéal physiologique. J’ai également souligné que la naissance de la démocratie en Grèce au Ve siècle avant J.C., se révélait inséparable du développement de la pensée rationnelle, et comment cette rationalité s’est trouvée elle-même conditionnée par la vie sociale. La transformation des pratiques sociales des Grecs qui s’étend du VIe au IVe siècle avant J.C., ne concerne pas seulement la vie politique, l’isonomie, sur laquelle elle se fonde, se révèle comme une matrice de civilisation qui décompose, recompose et modèle tous les secteurs de la vie sociale et réorganise les cadres de pensée. Le savoir rationnel émerge d’une émancipation politique, et en retour le savoir favorise le développement de l’émancipation.
Tant que la Loi qui gouverne une Cité ou une Nation est fondée sur les textes sacrés ou la tradition, on peut toujours discuter et se disputer à l’infini peu importe, mais le politique s’inscrit dans l’hétéronomie, il dépend d’une métaphysique, d’une religion ou d’une idéologie. À partir du moment où la Cité, la Nation écarte toute référence à une Loi sacrée, le politique s’ouvre sur le paradoxe d’une liberté qui oblige.
Je veux dire par là que le propre et l’apport d’une société authentiquement démocratique, c’est d’inviter les citoyens à se confronter à la question : que devons-nous penser dès lors que nous refusons que quelqu’un nous dicte ce que nous devons penser et faire ? Comment trouver des critères de vérité et de justice pour décider ? La question dès lors n’est plus de savoir si ce que l’on pense ou ce que l’on fait est conforme aux prescriptions des lois religieuses ou morales, mais plutôt de soutenir l’angoisse devant la liberté d’un être qui, avec ses égaux, dans le débat politique autant que scientifique, cherche les critères à même de fonder une vérité qui puisse donner un ordre au chaos.
C’est l’enseignement de l’histoire des démocraties, de leur origine à leur renouvellement constant : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » écrit René Char. Tel est le lien entre la démocratie et le savoir.
Au nom du savoir le pouvoir fabrique de la servitude volontaire
Mais qu’en est-il aujourd’hui des formes du savoir dans notre civilisation ? L’émancipation que permettait le savoir semble avoir laissé place à sa transformation en instrument de soumission sociale. Au nom du savoir, le pouvoir fabrique de la servitude volontaire. Le pilotage par les chiffres, dans tous les domaines de la vie sociale, marque un passage des discours narratifs de légitimation sociale aux discours non-narratifs. Cette transformation générale de la nature du savoir qui dicte aujourd’hui les manières de rendre compte du monde, de gouverner et de vivre, le rapproche sans cesse des lois indiscutables du sacré, nommé aujourd’hui pragmatisme. Cette transformation de la nature du savoir qui privilégie la part technique, instrumentale du langage – l’information – aux dépens de sa part fabulatrice, de ses fictions et de sa mise en récit, est un fait de civilisation, une machine de gouvernement autant qu’une fabrication des subjectivités. Le sens se perd au profit de la forme, le savoir est traduit et toléré uniquement dans le langage de machine. L’ordinateur qui calcule de manière prodigieuse toutes les données à sa portée, qui réalise merveilleusement toutes sortes d’opérations ne connaît pas le sens de ce qu’il fait. La connaissance devient une information-marchandise, et la hiérarchie des savoirs qui la composent repose sur la capacité de leurs résultats à être traduits dans ce langage de machine. Dans cette nouvelle forme de censure sociale des savoirs, l’art et les « humanités » sont les grands perdants.
Retrouver le goût de la culture et le sens de l’éducation populaire
Aussi importe-t-il de retrouver l’art de raconter et de partager nos expériences. C’est par le « souci » du récit, comme par les pratiques des arts, que nous pourrons lutter contre ce monde de mort, que nous pourrons retrouver le goût de la culture et le sens de l’éducation populaire sans lesquels nous perdrions notre « humanité dans l’homme » autant que notre dignité démocratique. À la suite de Jaurès, je pense qu’il ne saurait y avoir d’émancipation sociale et politique sans émancipation culturelle.
L’ouvrier, le paysan, l’enseignant, le médecin, le juge, le chercheur etc. qui voit son savoir et son savoir-faire confisqués par la machine (ou l’ordinateur) est devenu un prolétaire, un artisan exproprié de son acte et à terme de son existence. Seuls le récit, l’art, le débat scientifique, le débat politique, avec ce qu’ils permettent du partage de l’expérience et ce qu’ils postulent du principe d’une égalité, peuvent rétablir l’humain dans ses droits. Les chiffres nous serviront pour parler, pas pour nous faire taire. N’oublions pas que : « la raison est régulière comme un comptable ; la vie, anarchique comme un artiste ».
*Roland Gori est psychanalyste. Il est professeur émérite de psychopathologie à l’Université de Marseille. Il a initié l’Appel des appels.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 11 octobre 2012

Par un raccourci de la pensée, on associe culture et art et de façon plus radicale encore, on pense art à l’endroit exclusif de la culture ! Ces raccourcis font l’impasse malheureuse, voire aveugle, sur le monde du travail.
D ans le champ de nombreuses activités professionnelles, si on parle de règles de l’art, ce n’est pas pour faire un bon mot ou gonfler le torse. C’est parce que là aussi il est question d’interprétation, d’appropriation, de déploiement sensible, de création de sens ou de perte de sens, de savoir-faire sensoriel, d’émancipation collective, de luttes comme forces imaginaires, comme lieux de pensée. Par une désagréable habitude de faire plier le réel et vouloir toujours le nommer, nous filmons le travail et croyons le voir, nous en parlons et croyons le connaître, nous nous formons à lui et croyons l’avoir appréhendé, nous nous battons pour lui et croyons le servir.
Le travail engage des dispositions intellectuelles et sensorielles
Mais le travail n’est pas réductible à son apparent objet : la production (au sens générique du mot) et son répertoire de prescriptions, de savoir-faire, d’outils savants et d’ingéniosité managériale. Il engage des dispositions intellectuelles qui sont souvent invisibles, parfois secrètes, parfois inconscientes, parfois indicibles. Il engage des dispositions sensorielles difficilement transmissibles, fruits d’une expérience et d’une sensibilité personnelle, jamais réellement évaluées. Il engage une relation, une tension entre nous et lui, vécue au jour le jour et à chaque instant, qui façonne notre attention, nos intuitions, des automatismes, des micro-réflexions, des petites jubilations et/ou perplexités, une relation qui avance sans cesse et se développe, se braque et se déplie, se noie et se nourrit. Dans cette incroyable mobilisation de l’être, que chacun de nous nie, ignore ou sous-estime, au bureau, à l’atelier, au volant du camion, au comptoir, dans les champs ou au plus profond de la carrière, des trésors de réactivité, d’invention et d’à-propos, de finesse et de justesse, de précision et de beauté du geste, de raffinement et d’astuce, d’arbitrage esthétique, se créent sans cesse…
Il y a une déperdition et des malentendus dans l’approche du travail, entre le combat pour son effectivité et le combat pour son exercice. Autour de l’activité se pressent des enjeux antagonistes sur sa valeur, entre celle que lui accorde le marché du travail ou celle que le travaillant en attend. Le marché du travail, c’est l’adéquation entre son coût et ce qu’il rapporte. C’est ainsi qu’une certaine approche du travail a été confisquée par la nécessaire résistance à son organisation ou à son mobile véritable. Le besoin impérieux des donneurs d’ordre est de voir cette adéquation leur garantir des gains tangibles : la résistance a donc porté sur la durée, sur la pénibilité (les outils, le temps, les conditions), le coût horaire, les charges, les modalités de contre-pouvoir ou les monnaies d’échange, les congés, les pauses, les assurances, les retraites, les conditions sanitaires ou de sécurité, les contreparties sociales, etc. C’est la réponse nécessaire à ce qui est susceptible de détruire, à petit feu ou à grand feu, à ce qui ignore et indifférencie, normalise et minimise, à ce qui dévalorise et anéantit.
Seulement voilà, ces préoccupations militantes importantes font l’impasse sur ce qui se vit dans l’activité : ce qui est en jeu, ce qui s’y déploie et se construit, s’invente, forge du discernement est intimement lié au fait même que le travaillant a la (toute aussi impérieuse) nécessité d’être vivant, c’est à dire sensible et intelligent. Ici s’exerce la distanciation, se développe l’abstraction. Ici le travaillant joue, différencie, compare, choisit, donne le sens…
Prendre la mesure de l’intuition créatrice
Il faut donc parler un jour du désir et de la subjectivité. Évoquer l’attente. Prendre la mesure de l’intuition créatrice. Accepter de voir l’émancipation que toute activité professionnelle est en demeure de promettre.
Le combat du travaillant est un combat d’interprète, d’artiste, d’intellectuel ! Chaque jour se réinvente une micro-partie du travail, du côté du sens ou de l’esthétique (qu’on peut appeler aussi la justesse), du corps ou de l’idée. Et tout cela se sédimente, et se sédimente encore…
C’est ainsi que peu à peu s’inventent et s’écrivent les règles de l’art !
« Quand je vais au jardin, j’arrive, au bruit que fait la bêche à bien sentir la consistance de la terre, parce qu’il y a quelque chose à la fois de palpable dans le bruit et d’impalpable. Je suis sensible à l’eau, en écoutant la grosseur des gouttes sur le toit…, et je sens si l’atmosphère est humide en écoutant le bruit de mes pas dans l’herbe… » Chantal V.T. (jardinière)
« Quand une montre était exclusivement mécanique, on avait une partie de notre travail qui était pour l’œil, on voyait le mouvement du balancier, son amplitude. Si tout était correct, on écoutait ensuite les petits chuintements de métal, les frottements intempestifs. On mettait la montre à notre oreille, avec morceau de bois en guise de stéthoscope. » Yves N. (horloger)
« Le bruit de l’écoulement sur la coque, c’est ce qui vous permet d’avoir une idée exacte du cap que suit le bateau et de la vitesse qu’il a pris. S’il change, vous vous en rendez compte immédiatement. La nuit, vous ne voyez rien de l’extérieur, c’est le son qui va remplacer toute la vie, vous êtes dans le ventre du bateau, la coque fait caisse de résonance » Olivier D.K. (navigateur)
« J’aime mon atelier, je peux vous faire tourner la scie, vous allez voir. Les machines c’est mon bébé. Je suis là, les bruits sont normaux, le bébé va bien » Jean H. (graveur)
« La machine c’est une matière vivante. On sent la vie d’une installation au même titre qu’un individu. Un moteur qui chante, un moteur à courant continu, avec ses démarrages, ses ralentissements… je pourrais vous en parler… » Jacques L. (ascensoriste)
« J’aime bien entendre les gens qui parlent beaucoup, c’est la preuve que tout va bien, ils me font comprendre que l’ambiance est cordiale. Les chaises qui bougent lorsque quelqu’un part ou arrive, la fourchette qui tombe, je suis aux aguets. On aime essuyer les assiettes fort, c’est un besoin dans le métier, même les tasses… ça stimule… » Marie-Claude D. (gérante de bar)
« Quand on rassemble tous les bruits de marteau, on dirait que c’est des tams-tams. Même avec les vibreurs, t’entends de l’autre côté là ? il y a une espèce de changement, c’est comme de la musique orientale, je t’assure… Après c’est la massette, puis le Poclain, oui…, il y a 80 ou 100 personnes qui travaillent ici, qui jouent… c’est très très organisé ! » Tayeb A.A. (maçon) n
*Nicolas Frize est compositeur.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 11 octobre 2012
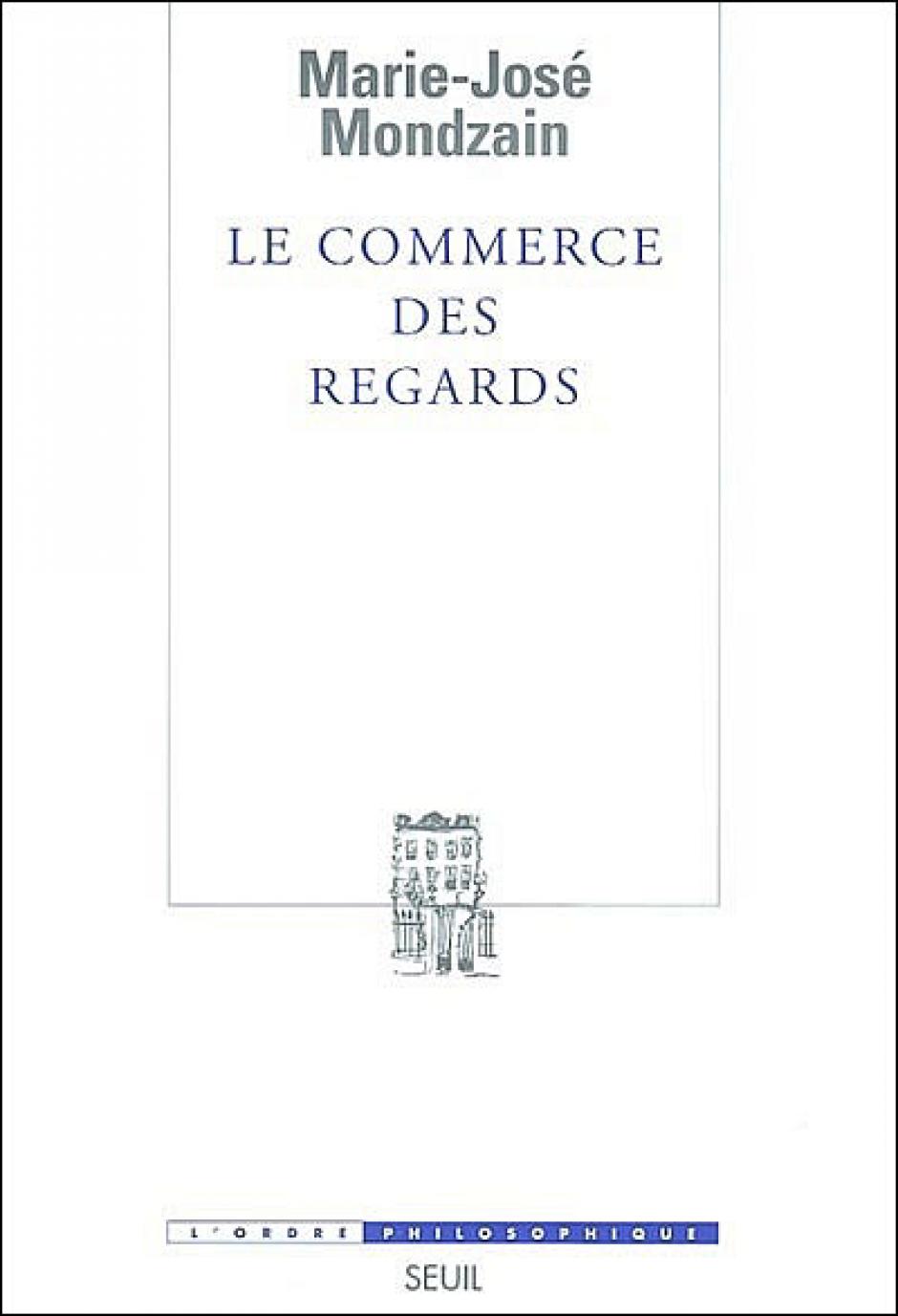
Une alliance empoisonnée de ce qui touche au plus près le domaine de la sensibilité, du sens et de la création, du savoir et de la recherche avec les instances technologiques des flux et avec le marché de la performance et du profit.
N ous voici pour la énième fois dotés d’un ministre de la Culture et de la Communication… La formule est née en 1981 lorsque Mitterand associa sans que personne bronche les anciennes Affaires culturelles aux procédures, aux techniques et technologies de la communication. Désormais c’est une seule et même institution qui gère un budget chargé de subvenir aux besoins contradictoires et pourtant désormais inséparés de la Culture et de la Communication. Nous sommes en 2012, le syntagme « Culture et Communication », si nous ne le dénonçons pas, finira peu à peu par passer pour une redondance puisque toutes les opérations symboliques, tous les gestes créatifs, les productions de la pensée et les capacités critiques relèvent d’un même pas de la Communication. Toutes les gestes de la pensée et les figures bigarrées du désir sont soumises aux exigences des TIC (Technologies de l’information et de la communication). La chose semble aller de soi ; on ne l’interroge plus. Pourtant se fait entendre depuis des années le grondement insistant, le murmure douloureux de toutes celles et de tous ceux qui sont chaque année, de plus en plus maltraités, de tous ces sujets doués de parole, de pensée et de puissance créatrice et critique qui, dans le monde de l’art comme dans celui de la science et de l’éducation, ne cessent de revendiquer et de défendre l’autonomie irréductible de leur pratique à l’égard des réquisits des industries de l’information et de la communication. C’est le mariage contre nature de ce qui touche au plus près le domaine de la sensibilité, du sens et de la création, du savoir et de la recherche avec les instances technologiques des flux et avec le marché de la performance et du profit. Nous réclamons leur divorce.
La Com’, c’est ainsi qu’on l’appelle, désigne en effet le règne technique et financier du pouvoir d’informer sur tout ce qui arrive, du pouvoir de définir le réel comme le probable, d’inscrire le nécessaire en déterminant l’impossible. Les experts de l’écran et les industriels de l’image imposent le lexique du commerce et posent sur leur pratique le masque de la démocratie, voire de la « culture populaire » alors que le pouvoir de la Com’ dissout méthodiquement toutes les ressources de la parole et de la pensée de ce qui fait justement advenir un peuple.
La paralysie de la pensée
Les experts des TIC organisent, avec les moyens remarquables de la balistique émotionnelle et d’une stratégie sans défaut, la paralysie de la pensée ; ils distribuent la jouissance et la terreur afin que nos lendemains aient forme de destin mondial sans alternative. Ce fameux « choc des cultures » nous prive de toute culture, à commencer par la nôtre.
Mais la Communication ne gère pas que le malheur, elle se veut aussi gestionnaire du bonheur. À côté du champ des catastrophes, elle doit organiser la liesse collective, les commémorations où se mêlent la rhétorique du deuil et celle de l’immortalité, les divertissements consolateurs ou le culte massifié du patrimoine. Autant d’opérations qui sont supposées produire du partage puisqu’elles rassemblent les consommateurs de l’info, les clients du marché des choses et le public de tous les spectacles de l’entertainment. Telle est la tâche des industries de programme.
Aujourd’hui le maître-mot de la Com’ c’est La Crise. C’est elle qui, digne de la majuscule, fait l’objet d’une communication aussi radicale que dévastatrice : il nous faut voir et savoir que le spectacle croissant de la misère, du chômage, de l’injustice et de la violence, tous les désespoirs, toutes les ruines ne sont que la figure moderne de la fatalité, d’une nécessité intrinsèque qui rendrait dérisoire voire réactionnaire toute volonté de transformer la matière résistante, aussi inerte qu’impalpable, du néocapitalisme mondialisé. La Crise exige deux choses : qu’on la supporte et qu’on l’oublie. La Crise, en termes de communication, est un état du monde qui produit un état des gens, leur mauvais état. Le passif vertigineux de la finance néolibérale demande à ses victimes d’être à leur tour passives et de préférence dans l’austérité. La Com’ donne des ordres destinés à nous faire accepter le désordre du monde. Il s’agit de nous convaincre que la crise n’est qu’une convulsion organique qui ne saurait en aucun cas être une crise de la culture elle-même. Il lui faut être à la fois supportée et non pensable. Pourtant il s’agit bien d’une véritable souffrance subjective, celle de tout vivant privé des ressources de sa parole, de la singularité de son désir et de sa relation intime à la dépense et à la gratuité. Mais la Com’ gère la circulation des signes comme on gère le commerce des choses et dans les institutions les responsables de la Culture adoptent à présent sans vergogne le lexique de l’évaluation, de l’audimat, de l’excellence et de la rentabilité pour soumettre l’art de chercher, de perdre et d’inventer aux lois de la concurrence et du marché. Le discours du maître ne fait qu’un avec le « discours du mètre ».
Qu’est-ce que la Culture ?
« Voilà pourquoi votre fille est muette » ! Resterons-nous sans voix ? On se souvient de Lucinde, dans le Médecin malgré lui, qui feint d’avoir perdu la parole parce qu’elle refuse l’alliance que son père lui impose. Il faut absolument que le mutisme général souhaité et imposé par les communicants ne soit à son tour de notre part que feinte et ruse, car nous devons impérativement refuser le destin que nous réservent les programmateurs de nos pensées, de nos désirs et de nos rêves. En effet qu’est-ce que la Culture si ce n’est d’abord et avant tout la capacité respectée, déployée et sans cesse accrue offerte à chacun sans distinction, de prendre la parole, de s’approprier sa langue, de construire sa mémoire, mais aussi de décider des figures de l’avenir, de s’emparer de la plasticité du réel pour en faire surgir l’inédit, l’inouï et l’infinité des possibles. Qu’est-ce que la Culture si elle ne concerne plus notre aptitude à renoncer à la jouissance pour partager la joie ? Autrement dit, sans la culture ainsi définie, il n’est aucun partage de la pensée, aucune construction symbolique, aucune opération innovante. Sans elle le mot politique n’est plus qu’un terme exsangue et vide. Cependant, qu’il soit clair qu’en aucun cas on ne peut séparer la culture de toutes les activités cognitives, qu’elles soient scientifiques ou de simple information. Loin de réduire la culture aux opérations du rêve et de la fiction, le ministère de la Culture, s’il doit être associé à un autre secteur institutionnel, doit bien au contraire accompagner les opérateurs de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Recherche. Ceux qui nous informent doivent être formés. Faire savoir, faire comprendre, ce n’est pas communiquer, c’est transmettre toutes les ressources acquises sous le régime d’un partage à la fois intellectuel et sensible, celui de la critique et du questionnement. Ni la culture, ni l’éducation ne sont affaire de vases « communicants ». Le champ de la mémoire, de la transmission, celui de la découverte et de la création sont inséparables. Ce sont là les sites de la dépense, de l’incertitude et du courage qui ouvrent à la transformation du monde et au surgissement de tous les possibles.
C’est au monde de la création, à celui de la pensée et à celui de la transmission des savoirs qu’il appartient de nous rendre les ressources de la transformation sociale et de la révolution politique. Car il faut bien admettre qu’un retour à la vie politique par les voies de la culture et de l’éducation ne peut être aujourd’hui qu’un projet révolutionnaire.
Retrouver la puissance des mots et des images
Il est important de saisir en quoi la crise actuelle, qui provoque la misère, le chômage et la ruine de pays entiers est désormais et plus que jamais une crise de la culture elle-même. Comment transformer un monde, comment même imaginer qu’il est transformable, quand le minerai inépuisable du possible est confisqué par les dispositifs d’une croyance collective en l’inéluctable et administré par les agents de l’information et du spectacle, tous experts de l’impossible. Nous pouvons refuser la rhétorique et la mise en spectacle du désastre inévitable et retrouver la puissance des mots et des images qui nous constituent en tant que sujets actifs de notre histoire. Ce sont les créateurs, les penseurs et les artistes qui ont le don de nous faire cette offre insigne et vigoureuse. Il appartient aux responsables de la Culture de les soutenir sans compter car ce sont eux qui nous permettent d’être libres, égaux et créatifs à notre tour. La Culture ne saurait être aux mains des comptables.
Voilà pourquoi il est urgent d’inscrire la possibilité du changement dans le refus explicite et militant de l’association asservissante de la Culture à la Communication. Sans cette condition, nous ne pouvons qu’assister à une berlusconisation de la société tout entière dont l’Italie ne se relève pas, même après le départ de Berlusconi. Un des plus grands témoins et visionnaires de cet effondrement symbolique fut Pasolini qui décrivait jour après jour cette lente dégradation de la culture populaire, cet embourgeoisement paradoxal du regard de la misère sur elle-même qui allait conduire l’Italie vers l’actuel néofascisme du capitalisme mondial. Pasolini déplorait la dévoration de l’énergie du peuple par un marché cannibale. Il dénonçait la consommation du spectacle qui progressivement consommait les spectateurs eux-mêmes, alors qu’il célébrait, lui, dans ses films la liberté révolutionnaire qui habitait la poétique des corps et des mots. Il voyait avec autant de génie que de rage lucide et désespérée que l’Italie devenait le laboratoire européen de cette alliance empoisonnée de la Culture avec la Communication.
Si la Culture c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs de transmission et de création, doit communiquer quelque chose, alors ce n’est rien d’autre qu’un mouvement, une énergie mobilisatrice, une force révolutionnaire qui fait appel, en chacun de nous tous sans distinction, à la croyance constituante en l’égalité et à la liberté.
*Marie-José Mondzain est philosophe. Elle est directrice de recherches émérite au CNRS.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012