le 12 October 2012

L’intermittence en soi ne saurait suffire à déterminer un « statut ». Elle n’est qu’une adaptation d’un mode particulier d’exercice du travail à la situation générale.
Nous avons tous rencontré un jour un enfant qui nous a dit : « Quand je serai grand, je serai comédien ! ». Ou danseur, ou pianiste, ou même ingénieur du son ou costumier(e). Je n’en ai pas encore rencontré qui m’ait dit : « Quand je serai grand, je serai intermittent ! ».
Pourtant, et notamment depuis une dizaine d’années et le conflit de 2003 consécutif à la « réforme » des annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC et la signature d’un nouveau protocole entre le patronat et les organisations syndicales de salariés, les luttes intenses de l’été 2003 ont fait entrer le mot dans la langue, sans autre précision. L’intermittent est devenu la figure obligée du travailleur du spectacle. Si bien qu’il n’est pas rare, y compris chez les intéressés eux-mêmes, d’entendre parler du « statut d’intermittent » : « Je viens enfin d’obtenir mon statut… », formule qui signifie que le salarié a enfin réussi à travailler suffisamment longtemps pour entrer dans le système, et y demeurer. On entend plus rarement dire : « J’ai enfin obtenu mon statut de précaire »…
Le terme est devenu comme un référent identitaire, en quelque sorte en creux. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que de voir ce régime spécifique d’assurance-chômage tenir lieu de « carte d’identité professionnelle » à ses bénéficiaires ! Un genre de « statut de l’artiste » par défaut en quelque sorte.
Il y a au moins deux grandes familles d’artistes : les interprètes et les auteurs. Les premiers sont comédiens, danseurs, musiciens instrumentistes, artistes de variétés… Les seconds sont écrivains, compositeurs, plasticiens… Ils sont auteurs. On les qualifie souvent de « créateurs ». Nul ne conteste que les uns et les autres soient des travailleurs, désireux de vivre de leur métier, de gagner correctement leur vie, de bénéficier d’une couverture sociale décente. Il n’en reste pas moins que nous avons affaire à deux statuts très différents : le statut de salarié et le statut d’auteur.
Toutes les batailles des travailleurs du spectacle, depuis des décennies, visent à ce que leurs droits sociaux soient les mêmes que ceux des autres travailleurs, ou qu’ils y tendent, qu’il s’agisse du droit à un contrat de travail, à une protection sociale digne, à une formation professionnelle continue, à des congés payés… bref, à des droits communs à ceux des autres salariés. L’intermittence en soi ne saurait suffire à déterminer un « statut ». Elle n’est qu’une adaptation d’un mode particulier d’exercice du travail à la situation générale.
Blocages et impasses de l’intermittence
Pierre-Michel Menger dans son dernier ouvrage (Les intermittents du spectacle, sociologie du travail flexible), nous donne les derniers chiffres disponibles : en 1992, les « intermittents » étaient 61 583. En 2007 ils étaient 137 307 (soit 223 %). Pendant ce temps le volume de travail mesuré en milliers d’équivalents-jours, est passé de 4 947 à 9 157 (soit 185 %) : le volume d’emploi croît beaucoup plus lentement que le nombre de travailleurs concernés. Un autre chiffre est encore plus paradoxal : le nombre des contrats de travail, dans cette même période, croît de… 460 % ! Comment interpréter cela ? Plusieurs raisons :
• Un nombre croissant de jeunes gens souhaite exercer un métier artistique. On peut s’en réjouir. Mais l’offre de travail ne suit pas. Ces activités sont étroitement tributaires de l’intervention publique. Or, à part la réelle progression des budgets culturels des collectivités, progression qui elle-même se ralentit brutalement, les budgets culturels stagnent.
• Les employeurs, profitant de l’aubaine du CDD d’usage, en profitent pour morceler à l’infini, à des fins d’ « optimisation » des plannings, les contrats de travail, d’où la croissance exponentielle de ces derniers.
• La « permittence » n’a pas été jugulée. Qu’est-ce donc ? Il suffit de déclarer comme « intermittents » des salariés travaillant
à l’année, à temps plein, chez un employeur unique. En effet pourquoi salarier quelqu’un 7 jours sur 7 si l’ASSEDIC peut en prendre en charge 4 ? C’est cynique ? Oui. C’est possible, sinon permis. On trouve ça partout, y compris chez les sociétés de l’audiovisuel public, les centres dramatiques nationaux, voire certains théâtres de villes même communistes.
La résorption de cette crise chronique est un casse-tête dont personne ne voit la sortie. Il est pourtant rapidement possible, au prix de quelques mesures réglementaires simples, de corriger ces dérives. On peut interdire l’usage du régime des annexes 8 et 10 pour certaines fonctions par essence permanentes. On peut aussi pénaliser de façon dissuasive les entreprises qui abusent du système, par exemple en jouant sur les taux de cotisations (un genre de bonus-malus), ou sur les subventions publiques. Il suffit d’un peu de volonté politique.
Enfin, on ne sortira pas durablement des « crises » qui affectent le régime de l’intermittence en se bornant à résorber des abus, resserrer encore le champ d’application ou réduire les prestations. Nul n’ignore que la consolidation du régime, depuis 1983 et ensuite, a concouru à faciliter l’entrée dans les professions du spectacle de nombre de jeunes professionnels, a permis à des centaines d’équipes artistiques, notamment dans le spectacle vivant, de se professionnaliser, et a par conséquent mis sur le marché du travail des milliers de jeunes artistes et techniciens. On ne saurait contester une telle dynamique, qui a correspondu à une période d’accroissement important des budgets culturels de l’État, puis des collectivités territoriales. Aujourd’hui la part de l’intervention publique (État, toutes administrations et collectivités territoriales, tous niveaux confondus) est d’environ 14 Md€, soit moins de 0,7 % du PIB, quand la dépense culturelle totale (pouvoirs publics, entreprises et particuliers) est de l’ordre de 80 Md€, soit 4 % du PIB environ. Notons au passage que la plupart de ces nouveaux emplois, avec la complicité des tutelles, ont largement profité de l’effet d’aubaine des annexes 8 & 10, et fort peu à l’emploi durable. Un directeur de CDN me racontait, alors qu’il procédait à la création d’un atelier de construction de décors pour son théâtre, et créait dans un premier temps deux emplois permanents de techniciens qualifiés, qu’il s’était fait tirer les oreilles par la DRAC (direction régionale de l’action culturelle) au prétexte qu’il aurait pu recourir à l’intermittence…
Quelles solutions ?
On ne réformera pas durablement l’intermittence si on ne revisite pas à fond les conditions d’exercice des métiers. On ne peut plus longtemps supporter que l’augmentation du volume de travail, réelle ces trente dernières années, se traduise par une augmentation plus grande encore du chômage et de la précarité. Il est inacceptable que l’intermittence, mode d’exercice inévitable, quoique non exclusif, des professions du spectacle, soit devenue une absence de choix.
Le « non-travail » d’un artiste interprète ou d’un collaborateur de création, technicien ou autre, n’est pas une période d’inactivité. Le danseur poursuivra l’entretien de son corps, plusieurs heures par jour ; le pianiste continuera à faire ses gammes ; le metteur en scène mettra à profit cette période de calme pour lire des textes ou réfléchir à son prochain projet ; l’éclairagiste, le machiniste ou le technicien du son se formera, visitera les salons professionnels, testera les nouveaux matériels ; etc. Le « chômage » des travailleurs du spectacle est le plus souvent une période d’intense activité. On estime que le « nouveau protocole » de 2003 a provoqué l’éviction du métier de plus de 20 000 professionnels par an, parmi les plus fragiles, même si le choc a fini par se lisser à la longue. Qui peut oser dire que c’est un « progrès » ?
Après avoir analysé les blocages et les impasses du système, force est de constater qu’on n’en sortira qu’en créant de l’emploi permanent. Dans l’audiovisuel, la résorption de la précarité devra porter sur tous les métiers qui n’ont aucune vocation à être « intermittents », et dans le spectacle vivant on développera les politiques dites de « permanence artistique ». Cela passe par un accompagnement suivi des pouvoirs publics, y compris financièrement. Si les études sur les « Pratiques culturelles des Français » de ces dernières décennies font apparaître une relative stagnation des publics, notamment du spectacle vivant, il est clair que les expériences de « permanence artistique » se sont toutes traduites par un élargissement durable des publics et créatrices d’emploi. Reste à consolider ces créations d’emploi en les rendant en grande partie pérennes. Exemple quasi-unique en France : le TNP de Villeurbanne, où Christian Schiaretti, poursuivant l’expérience engagée lorsqu’il était directeur de la Comédie de Reims, a reconstitué une troupe permanente, aujourd’hui composée de 14 artistes. Quelques Centres dramatiques et chorégraphiques commencent timidement à s’engager sur ce chemin.
Le seul gisement d’économies en matière d’intermittence est dans la création d’emplois permanents. Développer une politique audacieuse d’emploi permanent, artistique et technique, dans le spectacle, des milliers d’artistes et de techniciens sortiront par le haut du système, verront leur emploi consolidé, leur travail pérennisé et leur fonction sociale confortée. Les citoyens-spectateurs, actuels ou potentiels, verront les équipes artistiques de leur territoire en situation d’assumer leur fonction de « laboratoire du symbolique » et de « partage du sensible » au service de l’ensemble du peuple.
*Jean-Jacques Barey est opérateur culturel. Il est co-animateur du collectif Culture du PCF.
le 12 October 2012

Nicolas Dutent : À regarder vos films, on constate un désir insistant de goûter au portrait sociologique. Le cinéma vous permet-il de prolonger votre ambition et votre curiosité universitaires ?
Robert Guédiguian : Oui. De même que j’ai étudié les sciences économiques, la sociologie, un peu l’histoire… je me suis engagé en politique. Pour moi, c’est une manière de vivre, c’est une manière de m’interroger sur le réel, m’interroger sur moi aussi. Donc c’est évident que au moment où j’ai basculé par une espèce de hasard objectif dans le cinéma je suis resté le même homme : je suis resté sur les mêmes désirs, les mêmes motivations, les mêmes curiosités. C’est pour moi une évidence absolue : faire du cinéma, c’est ma manière de vivre. Ma manière a toujours été une manière curieuse, très tournée vers les autres, cherchant à expliquer le monde, autant qu’on le peut [...].
ND : En dehors des canaux traditionnels de la politique, qu’est-ce que le cinéma en tant que tel a pu vous offrir de plus, de complémentaire ou de tout aussi déterminant pour saisir le monde ?
RG : D’abord, étrangement, c’est une parole qui est plus écoutée parce qu’elle est plus libre. Elle ne contient pas au sens strict du terme un seul message, ce que peut faire un tract – et il peut y avoir de très beaux tracts. Les tracts, a priori, ne relèvent pas de l’expression artistique : ils vont droit au but, il faut un slogan à la fin, un mot d’ordre, un message très précis, etc. Le cinéma est plus large et plus complexe que ça et il est plus écouté parce que, plus complexe, il est perçu comme plus libre. De ce fait, ça a une force de frappe extrêmement puissante. Des millions de gens voient un film. Ils peuvent y apprendre à s’interroger ou à voir le monde différemment parce qu’on le leur a présenté à travers quelque chose qui est de l’ordre de la sensualité. C’est une connaissance différente et j’allais dire qui nous remue, qui nous travaille, qui part d’une émotion. L’étymologie d’émotion, c’est mouvement. [...]
Guillaume Quashie-Vauclin : Lénine dit du cinéma que c’est l’art des masses, un art à investir à des finalités politiques parce que, même comparé aux autres arts, il a une force de frappe populaire plus forte. Mais est-ce que tout le monde va voir Guédiguian ?
RG : C’est une question importante. Un peu taboue. J’ai toujours mis les pieds dans le plat pour ces questions-là. Je continue de me poser la question : comment faire pour que le public vienne voir mes films ? On ne peut pas intervenir sans se poser la question : à qui on parle ? à combien de gens on parle ? Dès lors, il faut se donner des moyens, y compris des moyens qui peuvent être internes à l’œuvre pour y arriver. Mais évidemment ça apparaît à tous les artistes échevelés comme hérésie : « L’art ne doit s’occuper de rien d’autre que de lui-même. » Je n’ai jamais pensé cela et je continue de faire des efforts. Mais alors des efforts sans concession.
Il faut faire des efforts mais il faut que le public en fasse aussi. Il faut que le public ait envie d’être réveillé, d’être secoué : on ne peut pas réveiller quelqu’un qui veut absolument continuer à dormir. Je prends le public pour un public adulte. Je considère qu’il peut tout entendre, qu’il peut tout regarder. Je veux bien faire un effort pour parler dans sa langue, pour me rapprocher de sa langue à lui, pour qu’il n’ait pas à me traduire, pour qu’il n’ait pas besoin d’intermédiaire. Pour ça, il y a différentes méthodes : j’ai toujours fait par exemple du cinéma qui contient une trame narrative lisible au premier degré. Ça, ça me semble le B-A-BA pour qu’un film soit public.
Il faut qu’il y ait une lecture au premier degré : un type qu’on présente, il lui arrive ça, ça, ça et ça. Il passe du bonheur au malheur ou du malheur au bonheur… Il faut une intrigue et un dénouement. On finit bien si c’est une comédie ; on finit mal si c’est une tragédie. Ce sont les règles du récit depuis la nuit des temps ! [...] Il y a des films sans récit que j’aime beaucoup ; mais moi je n’en ferai jamais parce que j’aurai trop peur que les gens aient trop de difficulté à m’entendre. [...]
ND : De quelle manière vous avez perçu Marius et Jeannette, moment de bascule à partir duquel une partie des critiques et du public vous ont découvert ?
RG : Il y avait comme une espèce de stratégie de conquête du public depuis quelques années. Je devais le penser inconsciemment avant de le faire. J’ai toujours voulu faire des films que mon père puisse regarder. C’est une formule commode mais mon père était ouvrier, en réparation navale sur les quais à Marseille : je pense qu’il a compris chacun de mes films. Je ne pense pas, j’en suis sûr. Ça, je le faisais consciemment. Mais à partir de L’Argent fait le bonheur, après Dieu vomit les tièdes d’ailleurs, et avec À la vie à la mort, je préparais le terrain pour Marius. Inconsciemment bien sûr. L’Argent fait le bonheur a très bien fonctionné. C’était un conte : il tordait le réel dans le bon sens.
Ce qu’on allait voir n’était pas tout à fait vrai, quoique plausible. C’était possible mais j’ai précisé que c’était un petit peu trop optimiste… À la vie à la mort a aussi été un grand succès critique. Les gens qui sont allés voir Marius attendaient la suite de ces deux films-là. Et c’est arrivé. Je ne savais pas bien sûr : je ne pouvais pas deviner que ça allait être un tel succès. Après, c’est le film lui-même, l’époque, l’histoire… Après, j’y peux plus rien. Mais la stratégie de conquête du pouvoir à travers la farce, la comédie, le conte, choses qui ont à voir avec Brecht d’ailleurs, avec la puissance des choses théâtrales, la musique à l’intérieur du film : c’est quelque chose de très volontaire. C’est-à-dire : il faut que les gens entendent cette parole-là.
GQV : Le héros positif. N’est-ce pas un aspect original de votre travail, notamment dans le cinéma contemporain qui se méfie de telles figures ?
RG : Je pense qu’il est effectivement intéressant de montrer des héros positifs.[...]Je crois que le cinéma doit aussi permettre de montrer des gens auxquels nous pouvons nous identifier. Ce qui est d’ailleurs la clé du succès public. Je ne suis pas là pour montrer seulement le monde tel qu’il ne va pas, déraisonne. Nous pouvons montrer en même temps en quoi il peut être source de réjouissance, comme il résiste et met en évidence des comportements quelquefois exemplaires. Dans L’Armée du Crime, les protagonistes sont bien entendu morts trop tôt et trop jeunes pour être mauvais ou jetés dans les compromis, ils ont accompli leurs vies. Toutes les lettres qu’ils écrivent avant de mourir sont d’ailleurs remplies de joie… Ils étaient à la fois forts et fous. Et sans vexer personne, notamment les descendants, je crois qu’on peut dire qu’ils ont pensé avoir « bien vécu » même s’ils ont vécus « court ». Ce sont en quelque sorte des « héros » au sens grec du terme, ils n’ont d’ailleurs pas souffert des affres de la vieillesse, ils sont morts jeunes, le corps intact… Mais ils n’en demeurent pas moins des sortes de héros positifs auxquels nous pouvons nous identifier (ce ne sont pas des gens « sans taches »). Ça existe et je ne vois pas pourquoi on ne le montrerait pas. Je suis toujours effaré par la manière dont la critique considère que tout ce qui est tragique, grave etc. l’emporte systématiquement sur la comédie. [...]
ND : Quelle place accordez-vous au spectre de votre enfance, votre éducation, vos lectures, votre apprentissage artistique… dans ce dont sont « faits » vos films ?
RG : Il y a déjà l’école. Mais la religion aussi. Je suis depuis longtemps athée, mais j’ai fait ma communion, suivi des cours de catéchisme. Ma mère est issue de Rhénanie, la seule région catholique d’Allemagne. Cet enseignement m’a au départ impressionné. L’approche du texte a été fondamentale : comme le dit Pasolini, les Évangiles sont un des plus beaux textes jamais écrits. Ce texte est remarquable même si je l’aborde personnellement comme une fiction. Mon premier rapport aux formes artistiques a été celui-ci. Les vitraux de la plus petite église du monde, celle de l’Estaque, étaient une expérience elle aussi incroyable. La lumière, les peintures, l’orgue, la musique… tout cela y participait également.
Ensuite il y a eu la rencontre décisive avec le père de Gérard Meylan, mon ami d’enfance. C’était un instituteur communiste, « le maître d’école ». J’aime d’ailleurs cette expression. Il était, comme beaucoup à l’époque, d’une érudition sans bornes. [...] Il avait réponse à tout. [...] Il était insomniaque et lisait un roman tous les jours. Ajouté à quoi il était un fin connaisseur de musique classique. Il me prêtait des vinyles, les symphonies de Beethoven… Cette rencontre a évidemment joué un rôle. Le Parti communiste de cette époque joue un rôle formidable, voire indispensable, d’éducation populaire. Les almanachs de l’Humanité de ces années me laissent aussi un émouvant souvenir, cela a touché toute une génération. Je suis ensuite allé chercher, vers l’âge de 15 ans et après, Pasolini, Fassbinder… et parce que je savais que leurs préoccupations résonnaient avec les miennes. Il y a eu donc tout cela et le fait que la religion, en tant que forme, m’intéresse depuis toujours. Elle est une source de production artistique immense, une des plus connues et usitées du reste.
GQV : La question du rapport à soi, de la fidélité à soi, est elle aussi très insistante chez vous…
RG : La fidélité à soi-même est c’est vrai une hygiène intellectuelle intéressante, même importante. S’interroger sans arrêt sur ce qu’on est et ce qu’on fait de soi, permet de vérifier – par delà les adaptations nécessaires, on ne pense pas nécessairement ou scrupuleusement la même chose à 20 ans et 40 ans, il faut considérer que des évolutions sont possibles et parfois souhaitables, on peut penser à 40 ans les mêmes choses qu’à 20 ans mais adaptées à aujourd’hui, au contexte – ce qui est passé entre les mailles du filet. Cet examen autocritique est indispensable, sain. C’est une belle chose qui peut nous permettre de considérer qu’on s’est éventuellement trompé à certains moments. Il n’y a rien dans cela de mortifère, cela peut même revêtir un aspect pétillant, cet examen donne de la vitalité. C’est ce que j’aime chez mes deux personnages principaux des Neiges du kilimandjaro… Au fond, ils se disent « on a été justes, mais peut-être aurait-on pu l’être encore un peu plus ». Cela peut d’ailleurs, et même souvent, interpeller le spectateur lui-même sur ce que ce sont devenus ses vieux rêves. [...] n
*Robert Guédiguian est cinéaste.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 12 October 2012

Après plusieurs mois de discussions infructueuses, la Ville de Paris vient d’annoncer brutalement la fin des subventions municipales au Théâtre Paris-Villette.[...]
À bien des égards, ce lieu est unique à Paris. Mais ce qui lui arrive s’inscrit dans un contexte, malheureusement préoccupant [...]
Dans tous les cas, la responsabilité de l’État et de la Ville est conjointe. À chaque fois, l’argument budgétaire invoqué est particulièrement dérisoire en regard des moyens dont dispose Paris, qui de toutes les grandes villes de France est celle qui consacre la plus petite part de son budget aux arts et à la culture [...]
Le Parti communiste français exprime son plus entier soutien à toute l’équipe du Paris-Villette comme aux artistes de cette saison, qui ont unanimement décidé d’assurer la programmation du théâtre sans certitude d’être rémunérés pour leur travail.[...]
Il exige que la Mairie de Paris garantisse dans un premier temps le financement de la programmation et du fonctionnement de la saison 2012-2013. Avec les élus au Conseil de Paris du PCF et du PG, il invite l’ensemble des groupes de la majorité municipale à se ressaisir et à redonner au Théâtre Paris-Villette les garanties de pérennité dont il a besoin, simplement pour vivre.
le 11 October 2012

Aujourd’hui la nouvelle colonisation des esprits passe par l’extension du langage de l’économie, de ses valeurs, de sa fonctionnalité, de ses caractères quasi anonymes, abstraits et sans expressivité, pour abolir les particularismes culturels des classes sociales et nier chaque subjectivité.
L’ humain se transforme en « capital » que l’on doit exploiter comme « ressources », et auquel on apprend à « gérer » ses émotions, son deuil, ses « habiletés sociales », ses « compétences cognitives », au prétexte d’accroître ses « performances » et sa « compétitivité ». La vie devient un champ de courses
avec ses « handicaps », ses départs, ses « deuxièmes chances » et son arrivée.
Au point que la notion d’handicap tend à envahir tous les champs : celui de l’école, de la psychiatrie, de la psychologie, de la médecine, du travail social, de l’économie, de la sociologie… Mais d’où vient ce mot ? Le terme provient de l’anglais hand in cap, « la main dans le chapeau », primitivement jeu de hasard appliqué ensuite aux courses de chevaux au XVIIIe siècle. Le terme « handicap » a été introduit en français « avec l’idée d’égaliser les chances des concurrents en imposant aux meilleurs de porter un poids plus grand ou de parcourir une distance plus longue. Par extension, le terme […] se dit de tout désavantage imposé dans une épreuve à un concurrent de qualité supérieure. De là vient […] le sens figuré d’“entrave, gêne”, “infériorité” […] » Le participe passé du verbe « handicaper », d’abord dans le domaine hippique et ensuite dans le champ social désigne une personne désavantagée, et notamment une personne désavantagée par une déficience physique ou mentale. C’est un concept très intimement lié à l’esprit de compétition établissant l’idée de jugement comparatif de la valeur des objets, des chevaux puis des personnes. Définir la souffrance d’un individu à la lumière de ses chances à concourir dans le champ social participe d’une civilisation sportivo-managériale des mœurs. L’extension aujourd’hui du terme, « handicap », se révèle comme un symptôme de la maladie de notre civilisation et des formes de savoir qu’elle produit.
Savoir, pouvoir et pratiques sociales
Les formes du savoir à une époque donnée et dans une société donnée sont inséparables des formes de pouvoir, des pratiques sociales en œuvre à ce moment-là. Cela ne veut pas dire bien évidemment que les découvertes scientifiques soient de pures constructions sociales – conception aussi absurde que dangereuse – mais que la culture, dont elles émergent, favorise ou inhibe leur apparition et leur développement. L’historien de la médecine, Henry Sigerist, montre que la découverte de la physiologie de la circulation par Harvey est inséparable de l’histoire intellectuelle de l’Europe au début du XVIIe siècle, de l’épanouissement du baroque, qui donne à la science médicale ce point de vue perspectiviste ouvert à l’illimité et l’infini qui permet de passer du modèle anatomique à l’idéal physiologique. J’ai également souligné que la naissance de la démocratie en Grèce au Ve siècle avant J.C., se révélait inséparable du développement de la pensée rationnelle, et comment cette rationalité s’est trouvée elle-même conditionnée par la vie sociale. La transformation des pratiques sociales des Grecs qui s’étend du VIe au IVe siècle avant J.C., ne concerne pas seulement la vie politique, l’isonomie, sur laquelle elle se fonde, se révèle comme une matrice de civilisation qui décompose, recompose et modèle tous les secteurs de la vie sociale et réorganise les cadres de pensée. Le savoir rationnel émerge d’une émancipation politique, et en retour le savoir favorise le développement de l’émancipation.
Tant que la Loi qui gouverne une Cité ou une Nation est fondée sur les textes sacrés ou la tradition, on peut toujours discuter et se disputer à l’infini peu importe, mais le politique s’inscrit dans l’hétéronomie, il dépend d’une métaphysique, d’une religion ou d’une idéologie. À partir du moment où la Cité, la Nation écarte toute référence à une Loi sacrée, le politique s’ouvre sur le paradoxe d’une liberté qui oblige.
Je veux dire par là que le propre et l’apport d’une société authentiquement démocratique, c’est d’inviter les citoyens à se confronter à la question : que devons-nous penser dès lors que nous refusons que quelqu’un nous dicte ce que nous devons penser et faire ? Comment trouver des critères de vérité et de justice pour décider ? La question dès lors n’est plus de savoir si ce que l’on pense ou ce que l’on fait est conforme aux prescriptions des lois religieuses ou morales, mais plutôt de soutenir l’angoisse devant la liberté d’un être qui, avec ses égaux, dans le débat politique autant que scientifique, cherche les critères à même de fonder une vérité qui puisse donner un ordre au chaos.
C’est l’enseignement de l’histoire des démocraties, de leur origine à leur renouvellement constant : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament » écrit René Char. Tel est le lien entre la démocratie et le savoir.
Au nom du savoir le pouvoir fabrique de la servitude volontaire
Mais qu’en est-il aujourd’hui des formes du savoir dans notre civilisation ? L’émancipation que permettait le savoir semble avoir laissé place à sa transformation en instrument de soumission sociale. Au nom du savoir, le pouvoir fabrique de la servitude volontaire. Le pilotage par les chiffres, dans tous les domaines de la vie sociale, marque un passage des discours narratifs de légitimation sociale aux discours non-narratifs. Cette transformation générale de la nature du savoir qui dicte aujourd’hui les manières de rendre compte du monde, de gouverner et de vivre, le rapproche sans cesse des lois indiscutables du sacré, nommé aujourd’hui pragmatisme. Cette transformation de la nature du savoir qui privilégie la part technique, instrumentale du langage – l’information – aux dépens de sa part fabulatrice, de ses fictions et de sa mise en récit, est un fait de civilisation, une machine de gouvernement autant qu’une fabrication des subjectivités. Le sens se perd au profit de la forme, le savoir est traduit et toléré uniquement dans le langage de machine. L’ordinateur qui calcule de manière prodigieuse toutes les données à sa portée, qui réalise merveilleusement toutes sortes d’opérations ne connaît pas le sens de ce qu’il fait. La connaissance devient une information-marchandise, et la hiérarchie des savoirs qui la composent repose sur la capacité de leurs résultats à être traduits dans ce langage de machine. Dans cette nouvelle forme de censure sociale des savoirs, l’art et les « humanités » sont les grands perdants.
Retrouver le goût de la culture et le sens de l’éducation populaire
Aussi importe-t-il de retrouver l’art de raconter et de partager nos expériences. C’est par le « souci » du récit, comme par les pratiques des arts, que nous pourrons lutter contre ce monde de mort, que nous pourrons retrouver le goût de la culture et le sens de l’éducation populaire sans lesquels nous perdrions notre « humanité dans l’homme » autant que notre dignité démocratique. À la suite de Jaurès, je pense qu’il ne saurait y avoir d’émancipation sociale et politique sans émancipation culturelle.
L’ouvrier, le paysan, l’enseignant, le médecin, le juge, le chercheur etc. qui voit son savoir et son savoir-faire confisqués par la machine (ou l’ordinateur) est devenu un prolétaire, un artisan exproprié de son acte et à terme de son existence. Seuls le récit, l’art, le débat scientifique, le débat politique, avec ce qu’ils permettent du partage de l’expérience et ce qu’ils postulent du principe d’une égalité, peuvent rétablir l’humain dans ses droits. Les chiffres nous serviront pour parler, pas pour nous faire taire. N’oublions pas que : « la raison est régulière comme un comptable ; la vie, anarchique comme un artiste ».
*Roland Gori est psychanalyste. Il est professeur émérite de psychopathologie à l’Université de Marseille. Il a initié l’Appel des appels.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 11 October 2012

Par un raccourci de la pensée, on associe culture et art et de façon plus radicale encore, on pense art à l’endroit exclusif de la culture ! Ces raccourcis font l’impasse malheureuse, voire aveugle, sur le monde du travail.
D ans le champ de nombreuses activités professionnelles, si on parle de règles de l’art, ce n’est pas pour faire un bon mot ou gonfler le torse. C’est parce que là aussi il est question d’interprétation, d’appropriation, de déploiement sensible, de création de sens ou de perte de sens, de savoir-faire sensoriel, d’émancipation collective, de luttes comme forces imaginaires, comme lieux de pensée. Par une désagréable habitude de faire plier le réel et vouloir toujours le nommer, nous filmons le travail et croyons le voir, nous en parlons et croyons le connaître, nous nous formons à lui et croyons l’avoir appréhendé, nous nous battons pour lui et croyons le servir.
Le travail engage des dispositions intellectuelles et sensorielles
Mais le travail n’est pas réductible à son apparent objet : la production (au sens générique du mot) et son répertoire de prescriptions, de savoir-faire, d’outils savants et d’ingéniosité managériale. Il engage des dispositions intellectuelles qui sont souvent invisibles, parfois secrètes, parfois inconscientes, parfois indicibles. Il engage des dispositions sensorielles difficilement transmissibles, fruits d’une expérience et d’une sensibilité personnelle, jamais réellement évaluées. Il engage une relation, une tension entre nous et lui, vécue au jour le jour et à chaque instant, qui façonne notre attention, nos intuitions, des automatismes, des micro-réflexions, des petites jubilations et/ou perplexités, une relation qui avance sans cesse et se développe, se braque et se déplie, se noie et se nourrit. Dans cette incroyable mobilisation de l’être, que chacun de nous nie, ignore ou sous-estime, au bureau, à l’atelier, au volant du camion, au comptoir, dans les champs ou au plus profond de la carrière, des trésors de réactivité, d’invention et d’à-propos, de finesse et de justesse, de précision et de beauté du geste, de raffinement et d’astuce, d’arbitrage esthétique, se créent sans cesse…
Il y a une déperdition et des malentendus dans l’approche du travail, entre le combat pour son effectivité et le combat pour son exercice. Autour de l’activité se pressent des enjeux antagonistes sur sa valeur, entre celle que lui accorde le marché du travail ou celle que le travaillant en attend. Le marché du travail, c’est l’adéquation entre son coût et ce qu’il rapporte. C’est ainsi qu’une certaine approche du travail a été confisquée par la nécessaire résistance à son organisation ou à son mobile véritable. Le besoin impérieux des donneurs d’ordre est de voir cette adéquation leur garantir des gains tangibles : la résistance a donc porté sur la durée, sur la pénibilité (les outils, le temps, les conditions), le coût horaire, les charges, les modalités de contre-pouvoir ou les monnaies d’échange, les congés, les pauses, les assurances, les retraites, les conditions sanitaires ou de sécurité, les contreparties sociales, etc. C’est la réponse nécessaire à ce qui est susceptible de détruire, à petit feu ou à grand feu, à ce qui ignore et indifférencie, normalise et minimise, à ce qui dévalorise et anéantit.
Seulement voilà, ces préoccupations militantes importantes font l’impasse sur ce qui se vit dans l’activité : ce qui est en jeu, ce qui s’y déploie et se construit, s’invente, forge du discernement est intimement lié au fait même que le travaillant a la (toute aussi impérieuse) nécessité d’être vivant, c’est à dire sensible et intelligent. Ici s’exerce la distanciation, se développe l’abstraction. Ici le travaillant joue, différencie, compare, choisit, donne le sens…
Prendre la mesure de l’intuition créatrice
Il faut donc parler un jour du désir et de la subjectivité. Évoquer l’attente. Prendre la mesure de l’intuition créatrice. Accepter de voir l’émancipation que toute activité professionnelle est en demeure de promettre.
Le combat du travaillant est un combat d’interprète, d’artiste, d’intellectuel ! Chaque jour se réinvente une micro-partie du travail, du côté du sens ou de l’esthétique (qu’on peut appeler aussi la justesse), du corps ou de l’idée. Et tout cela se sédimente, et se sédimente encore…
C’est ainsi que peu à peu s’inventent et s’écrivent les règles de l’art !
« Quand je vais au jardin, j’arrive, au bruit que fait la bêche à bien sentir la consistance de la terre, parce qu’il y a quelque chose à la fois de palpable dans le bruit et d’impalpable. Je suis sensible à l’eau, en écoutant la grosseur des gouttes sur le toit…, et je sens si l’atmosphère est humide en écoutant le bruit de mes pas dans l’herbe… » Chantal V.T. (jardinière)
« Quand une montre était exclusivement mécanique, on avait une partie de notre travail qui était pour l’œil, on voyait le mouvement du balancier, son amplitude. Si tout était correct, on écoutait ensuite les petits chuintements de métal, les frottements intempestifs. On mettait la montre à notre oreille, avec morceau de bois en guise de stéthoscope. » Yves N. (horloger)
« Le bruit de l’écoulement sur la coque, c’est ce qui vous permet d’avoir une idée exacte du cap que suit le bateau et de la vitesse qu’il a pris. S’il change, vous vous en rendez compte immédiatement. La nuit, vous ne voyez rien de l’extérieur, c’est le son qui va remplacer toute la vie, vous êtes dans le ventre du bateau, la coque fait caisse de résonance » Olivier D.K. (navigateur)
« J’aime mon atelier, je peux vous faire tourner la scie, vous allez voir. Les machines c’est mon bébé. Je suis là, les bruits sont normaux, le bébé va bien » Jean H. (graveur)
« La machine c’est une matière vivante. On sent la vie d’une installation au même titre qu’un individu. Un moteur qui chante, un moteur à courant continu, avec ses démarrages, ses ralentissements… je pourrais vous en parler… » Jacques L. (ascensoriste)
« J’aime bien entendre les gens qui parlent beaucoup, c’est la preuve que tout va bien, ils me font comprendre que l’ambiance est cordiale. Les chaises qui bougent lorsque quelqu’un part ou arrive, la fourchette qui tombe, je suis aux aguets. On aime essuyer les assiettes fort, c’est un besoin dans le métier, même les tasses… ça stimule… » Marie-Claude D. (gérante de bar)
« Quand on rassemble tous les bruits de marteau, on dirait que c’est des tams-tams. Même avec les vibreurs, t’entends de l’autre côté là ? il y a une espèce de changement, c’est comme de la musique orientale, je t’assure… Après c’est la massette, puis le Poclain, oui…, il y a 80 ou 100 personnes qui travaillent ici, qui jouent… c’est très très organisé ! » Tayeb A.A. (maçon) n
*Nicolas Frize est compositeur.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 11 October 2012
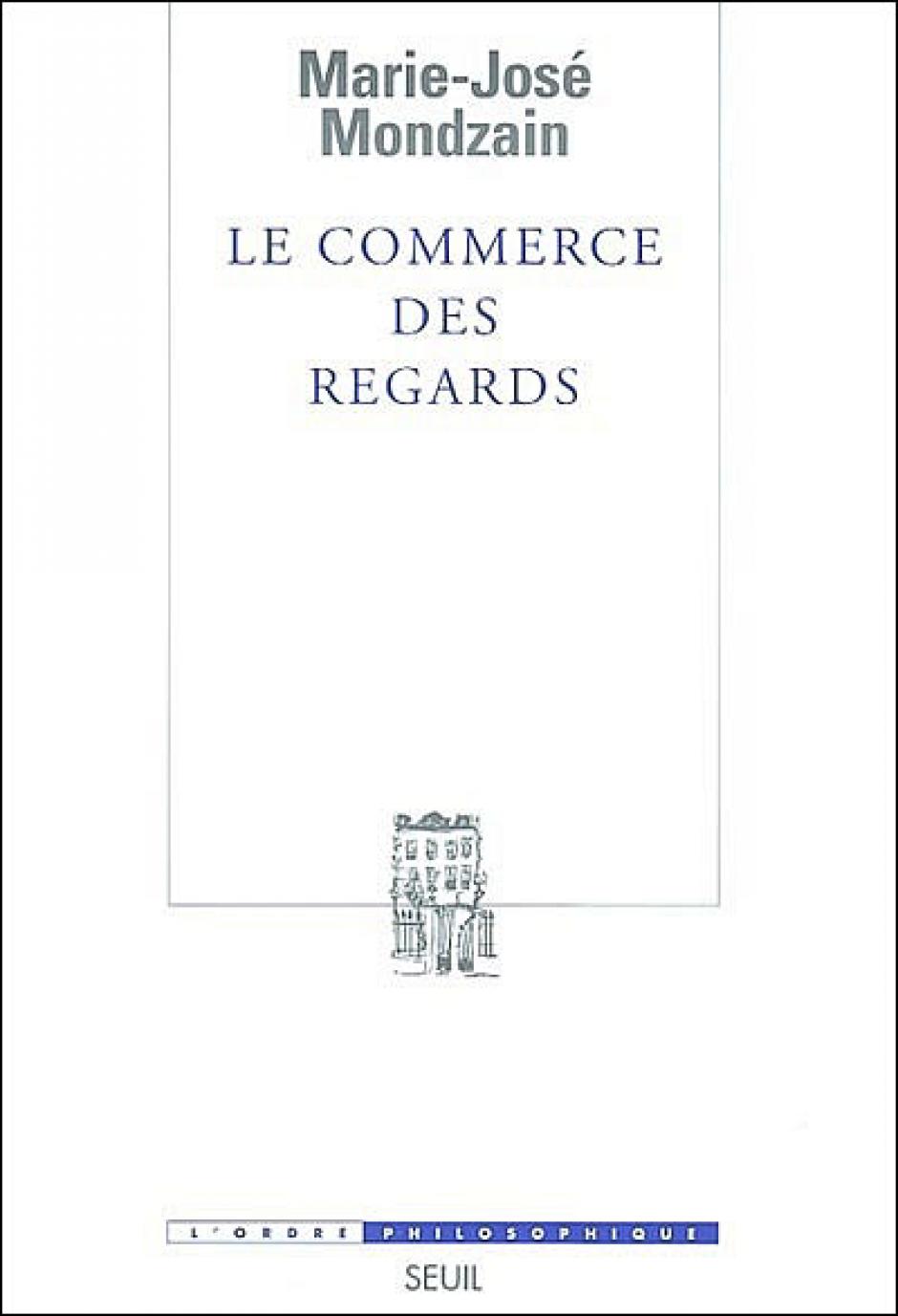
Une alliance empoisonnée de ce qui touche au plus près le domaine de la sensibilité, du sens et de la création, du savoir et de la recherche avec les instances technologiques des flux et avec le marché de la performance et du profit.
N ous voici pour la énième fois dotés d’un ministre de la Culture et de la Communication… La formule est née en 1981 lorsque Mitterand associa sans que personne bronche les anciennes Affaires culturelles aux procédures, aux techniques et technologies de la communication. Désormais c’est une seule et même institution qui gère un budget chargé de subvenir aux besoins contradictoires et pourtant désormais inséparés de la Culture et de la Communication. Nous sommes en 2012, le syntagme « Culture et Communication », si nous ne le dénonçons pas, finira peu à peu par passer pour une redondance puisque toutes les opérations symboliques, tous les gestes créatifs, les productions de la pensée et les capacités critiques relèvent d’un même pas de la Communication. Toutes les gestes de la pensée et les figures bigarrées du désir sont soumises aux exigences des TIC (Technologies de l’information et de la communication). La chose semble aller de soi ; on ne l’interroge plus. Pourtant se fait entendre depuis des années le grondement insistant, le murmure douloureux de toutes celles et de tous ceux qui sont chaque année, de plus en plus maltraités, de tous ces sujets doués de parole, de pensée et de puissance créatrice et critique qui, dans le monde de l’art comme dans celui de la science et de l’éducation, ne cessent de revendiquer et de défendre l’autonomie irréductible de leur pratique à l’égard des réquisits des industries de l’information et de la communication. C’est le mariage contre nature de ce qui touche au plus près le domaine de la sensibilité, du sens et de la création, du savoir et de la recherche avec les instances technologiques des flux et avec le marché de la performance et du profit. Nous réclamons leur divorce.
La Com’, c’est ainsi qu’on l’appelle, désigne en effet le règne technique et financier du pouvoir d’informer sur tout ce qui arrive, du pouvoir de définir le réel comme le probable, d’inscrire le nécessaire en déterminant l’impossible. Les experts de l’écran et les industriels de l’image imposent le lexique du commerce et posent sur leur pratique le masque de la démocratie, voire de la « culture populaire » alors que le pouvoir de la Com’ dissout méthodiquement toutes les ressources de la parole et de la pensée de ce qui fait justement advenir un peuple.
La paralysie de la pensée
Les experts des TIC organisent, avec les moyens remarquables de la balistique émotionnelle et d’une stratégie sans défaut, la paralysie de la pensée ; ils distribuent la jouissance et la terreur afin que nos lendemains aient forme de destin mondial sans alternative. Ce fameux « choc des cultures » nous prive de toute culture, à commencer par la nôtre.
Mais la Communication ne gère pas que le malheur, elle se veut aussi gestionnaire du bonheur. À côté du champ des catastrophes, elle doit organiser la liesse collective, les commémorations où se mêlent la rhétorique du deuil et celle de l’immortalité, les divertissements consolateurs ou le culte massifié du patrimoine. Autant d’opérations qui sont supposées produire du partage puisqu’elles rassemblent les consommateurs de l’info, les clients du marché des choses et le public de tous les spectacles de l’entertainment. Telle est la tâche des industries de programme.
Aujourd’hui le maître-mot de la Com’ c’est La Crise. C’est elle qui, digne de la majuscule, fait l’objet d’une communication aussi radicale que dévastatrice : il nous faut voir et savoir que le spectacle croissant de la misère, du chômage, de l’injustice et de la violence, tous les désespoirs, toutes les ruines ne sont que la figure moderne de la fatalité, d’une nécessité intrinsèque qui rendrait dérisoire voire réactionnaire toute volonté de transformer la matière résistante, aussi inerte qu’impalpable, du néocapitalisme mondialisé. La Crise exige deux choses : qu’on la supporte et qu’on l’oublie. La Crise, en termes de communication, est un état du monde qui produit un état des gens, leur mauvais état. Le passif vertigineux de la finance néolibérale demande à ses victimes d’être à leur tour passives et de préférence dans l’austérité. La Com’ donne des ordres destinés à nous faire accepter le désordre du monde. Il s’agit de nous convaincre que la crise n’est qu’une convulsion organique qui ne saurait en aucun cas être une crise de la culture elle-même. Il lui faut être à la fois supportée et non pensable. Pourtant il s’agit bien d’une véritable souffrance subjective, celle de tout vivant privé des ressources de sa parole, de la singularité de son désir et de sa relation intime à la dépense et à la gratuité. Mais la Com’ gère la circulation des signes comme on gère le commerce des choses et dans les institutions les responsables de la Culture adoptent à présent sans vergogne le lexique de l’évaluation, de l’audimat, de l’excellence et de la rentabilité pour soumettre l’art de chercher, de perdre et d’inventer aux lois de la concurrence et du marché. Le discours du maître ne fait qu’un avec le « discours du mètre ».
Qu’est-ce que la Culture ?
« Voilà pourquoi votre fille est muette » ! Resterons-nous sans voix ? On se souvient de Lucinde, dans le Médecin malgré lui, qui feint d’avoir perdu la parole parce qu’elle refuse l’alliance que son père lui impose. Il faut absolument que le mutisme général souhaité et imposé par les communicants ne soit à son tour de notre part que feinte et ruse, car nous devons impérativement refuser le destin que nous réservent les programmateurs de nos pensées, de nos désirs et de nos rêves. En effet qu’est-ce que la Culture si ce n’est d’abord et avant tout la capacité respectée, déployée et sans cesse accrue offerte à chacun sans distinction, de prendre la parole, de s’approprier sa langue, de construire sa mémoire, mais aussi de décider des figures de l’avenir, de s’emparer de la plasticité du réel pour en faire surgir l’inédit, l’inouï et l’infinité des possibles. Qu’est-ce que la Culture si elle ne concerne plus notre aptitude à renoncer à la jouissance pour partager la joie ? Autrement dit, sans la culture ainsi définie, il n’est aucun partage de la pensée, aucune construction symbolique, aucune opération innovante. Sans elle le mot politique n’est plus qu’un terme exsangue et vide. Cependant, qu’il soit clair qu’en aucun cas on ne peut séparer la culture de toutes les activités cognitives, qu’elles soient scientifiques ou de simple information. Loin de réduire la culture aux opérations du rêve et de la fiction, le ministère de la Culture, s’il doit être associé à un autre secteur institutionnel, doit bien au contraire accompagner les opérateurs de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Recherche. Ceux qui nous informent doivent être formés. Faire savoir, faire comprendre, ce n’est pas communiquer, c’est transmettre toutes les ressources acquises sous le régime d’un partage à la fois intellectuel et sensible, celui de la critique et du questionnement. Ni la culture, ni l’éducation ne sont affaire de vases « communicants ». Le champ de la mémoire, de la transmission, celui de la découverte et de la création sont inséparables. Ce sont là les sites de la dépense, de l’incertitude et du courage qui ouvrent à la transformation du monde et au surgissement de tous les possibles.
C’est au monde de la création, à celui de la pensée et à celui de la transmission des savoirs qu’il appartient de nous rendre les ressources de la transformation sociale et de la révolution politique. Car il faut bien admettre qu’un retour à la vie politique par les voies de la culture et de l’éducation ne peut être aujourd’hui qu’un projet révolutionnaire.
Retrouver la puissance des mots et des images
Il est important de saisir en quoi la crise actuelle, qui provoque la misère, le chômage et la ruine de pays entiers est désormais et plus que jamais une crise de la culture elle-même. Comment transformer un monde, comment même imaginer qu’il est transformable, quand le minerai inépuisable du possible est confisqué par les dispositifs d’une croyance collective en l’inéluctable et administré par les agents de l’information et du spectacle, tous experts de l’impossible. Nous pouvons refuser la rhétorique et la mise en spectacle du désastre inévitable et retrouver la puissance des mots et des images qui nous constituent en tant que sujets actifs de notre histoire. Ce sont les créateurs, les penseurs et les artistes qui ont le don de nous faire cette offre insigne et vigoureuse. Il appartient aux responsables de la Culture de les soutenir sans compter car ce sont eux qui nous permettent d’être libres, égaux et créatifs à notre tour. La Culture ne saurait être aux mains des comptables.
Voilà pourquoi il est urgent d’inscrire la possibilité du changement dans le refus explicite et militant de l’association asservissante de la Culture à la Communication. Sans cette condition, nous ne pouvons qu’assister à une berlusconisation de la société tout entière dont l’Italie ne se relève pas, même après le départ de Berlusconi. Un des plus grands témoins et visionnaires de cet effondrement symbolique fut Pasolini qui décrivait jour après jour cette lente dégradation de la culture populaire, cet embourgeoisement paradoxal du regard de la misère sur elle-même qui allait conduire l’Italie vers l’actuel néofascisme du capitalisme mondial. Pasolini déplorait la dévoration de l’énergie du peuple par un marché cannibale. Il dénonçait la consommation du spectacle qui progressivement consommait les spectateurs eux-mêmes, alors qu’il célébrait, lui, dans ses films la liberté révolutionnaire qui habitait la poétique des corps et des mots. Il voyait avec autant de génie que de rage lucide et désespérée que l’Italie devenait le laboratoire européen de cette alliance empoisonnée de la Culture avec la Communication.
Si la Culture c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs de transmission et de création, doit communiquer quelque chose, alors ce n’est rien d’autre qu’un mouvement, une énergie mobilisatrice, une force révolutionnaire qui fait appel, en chacun de nous tous sans distinction, à la croyance constituante en l’égalité et à la liberté.
*Marie-José Mondzain est philosophe. Elle est directrice de recherches émérite au CNRS.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 11 October 2012

La culture est l’expression de la solidarité humaine. Soyons ambitieux et mettons tout en œuvre pour refonder un service public de l’art et de la culture national et décentralisé;
«Défendre la culture, ce n’est pas lutter pour ou contre une politique culturelle, c’est lutter contre l’effondrement du politique. », nous dit Marie-José Mondzain. En effet, la culture n’est pas un enjeu spécifique à un secteur d’activité qui ne concernerait que ses propres acteurs. C’est l’expression de la solidarité humaine. Sa vitalité est la condition de la vie politique elle-même. Elle est ce qui donne sa chance à la création, à l’invention, donc au changement.
Depuis des années, nous sommes engagés dans un processus d’effacement de la vie politique, des conditions de possibilité du débat, de la contradiction. C’est un phénomène qui nous concerne tous au quotidien et d’abord au travail. L’imaginaire est en souffrance. Le péril est d’ordre anthropologique. En ces temps où se bousculent et s’accélèrent tant de mutations au potentiel émancipateur considérable, du numérique à l’écologique et à la mondialisation des relations, des activités et des créations humaines, le besoin de déchiffrer le présent et d’imaginer de nouveaux horizons s’éprouve encore davantage.
Parce qu’il s’agit de mettre en débat des alternatives, de nommer les souhaits communs de celles et ceux qui rêvent d’un monde nouveau, nous voulons faire de la culture un moteur de la transformation sociale. Les forces de la création, conjointement à celles du travail, doivent reprendre le pouvoir sur les mots et les symboles que le capitalisme financier a détournés de leur sens pour imposer ses seuls critères quantitatifs et concurrentiels à tout le champ des activités humaines.
C’est pourquoi nous ne devons pas nous contenter d’interpeller le nouveau pouvoir politique, de lui demander d’avoir une « meilleure politique culturelle ». Nous devons être en première ligne pour proposer et initier une alternative. Et il en va de la crédibilité de l’ensemble de notre démarche qui peu ou prou prend la forme d’un grand chantier concomitant de création et d’éducation populaire, à l’école, dans les entreprises et dans les territoires.
La démocratisation culturelle
Il fut un temps où la marge tenait le cahier. Le service public de la culture, comme celui du gaz ou de l’électricité, avait pour mission de s’adresser à tous. Les expériences menées dans des territoires de l’art régulièrement réinventés pouvaient encore contester aux institutions leur capacité d’innovation pour inspirer in fine à celles-ci une relation renouvelée entre les œuvres et leurs publics, entre l’art et la République. Peu à peu, au corps défendant de la plupart des acteurs sincères de la démocratisation culturelle et à mesure que le libéralisme imposait son hégémonie culturelle, le consumérisme a pénétré l’ensemble de nos pratiques.
Nous partons d’un postulat simple : nous sommes tous égaux en dignité et en liberté… donc nous avons droit à la beauté, à l’émotion, aux joies. Et chacun doit pouvoir entrer en conversation avec l’autre. Il revient à la puissance publique de définir des directions et des missions. Elle doit favoriser l’expérimentation, autoriser la permanence mais aussi permettre le nomadisme, encourager la diversité et la singularité. Elle est garante de l’imprévisibilité souhaitée.
Réinventer
Par un processus d’écriture démocratique, nous devons changer les paramètres en réinventant les dispositifs institutionnels que nous prendrons soin de ne pas considérer comme définitifs, car la révolution citoyenne est un processus. Nous devons opérer un retournement de pensée en conjuguant démocratisation et démocratie culturelle, c’est-à-dire prendre en compte la capacité de création de tous et de chacun dans le travail comme dans la société.
Alors que le capitalisme tente de fabriquer des humains normés, conformistes et dociles, notre projet vise l’émancipation de tous et l’épanouissement de chacun. Une politique culturelle dans cette perspective, n’est pas l’affaire seulement des artistes et des acteurs culturels, elle doit s’adresser à toute la société et mobiliser l’ensemble des citoyens. Elle a pour objectif de faire de chacune et chacun d’entre nous l’acteur de son propre destin. Pour reprendre la formule de Roland Gori, « il n’y a pas d’émancipation politique sans émancipation culturelle ».
Notre ambition ne se limite donc pas à garantir les moyens qui permettent à l’artiste de vivre et travailler, à assurer des revenus, salariaux et autres, à l’ensemble des travailleurs de la culture et des arts. Nous voulons libérer de la précarité l’ensemble des métiers et remettre en cause tout ce qui, dans le travail sous domination des critères capitalistes, éteint la créativité. Au delà de la défense de l’intermittence nous voulons créer les conditions d’une permanence de la recherche et de la production artistique.
Donner un nouveau souffle à l’imaginaire collectif
Pour cela, une politique publique de la culture doit en premier lieu garantir la liberté totale d’expression et de création pour les artistes et les acteurs culturels, dont le travail doit être protégé contre toute instrumentalisation politique ou religieuse et tout asservissement à une économie de la culture marchandisée. Il faut dans un même mouvement donner un nouveau souffle à l’imaginaire collectif en portant l’ambition d’un nouveau « partage du sensible ». Il faut enfin admettre que le vivre ensemble suppose la reconnaissance de l’autre, dans la diversité de son histoire, de sa culture et de sa langue.
Répondre à ces exigences est d’autant plus urgent que le mouvement culturel est aux prises avec les ruptures régressives impulsées par la droite dans toutes ses composantes et les forces de l’argent. Cela s’est exprimé sous l’ère Sarkozy par une offensive sans précédent contre le service public de la culture et les politiques mises en place depuis le Front populaire puis la Libération, institutionnalisées et généralisées après la création du ministère de la culture et l’accompagnement des collectivités territoriales.
« Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve » écrivait Hölderlin. Le temps de la résistance ne peut se concevoir aujourd’hui que dans le temps de la rupture et de la reconstruction d’une alternative à ce monde vermoulu par l’argent, la concurrence entre les individus, la peur et la haine de l’autre.
C’est pourquoi le Parti communiste et le Front de gauche opposent à cela une grande ambition et le développement de moyens nouveaux au service de la refondation d’un service public de l’art et de la culture national et décentralisé. C’est pourquoi nous proposons d’ouvrir sans attendre un vaste chantier citoyen de coélaboration d’une loi cadre d’orientation et de programmation pour les arts, la culture et les média.
La culture est un droit fondamental. Développer les politiques publiques d’élévation, de transmission et d’appropriation permanente de la connaissance et de l’imaginaire, c’est faire vivre les valeurs de solidarité, d’égalité et de liberté, c’est vouloir que la citoyenneté et la démocratie puissent pleinement s’exercer : voilà pourquoi la culture doit être une priorité au même titre que l’éducation.
À l’heure où l’obscurantisme et le populisme se conjuguent à de formidables régressions sociales, il est urgent de retrouver les chemins de l’espérance et de l’utopie.
Qu’est-ce qu’on attend pour prendre le pouvoir ?
*Alain Hayot est responsable du collectif Culture du PCF.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 11 October 2012

«Dès l’instant où l’on commence à répartir le travail, chacun a une sphère d’activité déterminée et exclusive qu’on lui impose et dont il ne peut s’évader ; il est chasseur, pêcheur, berger ou " critique critique ", et il doit le rester sous peine de perdre les moyens de subsistance – alors que dans la société communiste, où chacun, au lieu d’avoir une sphère d’activité exclusive, peut se former dans la branche qui lui plaît ; c’est la société qui dirige la production générale qui me permet ainsi de faire aujourd’hui ceci, demain cela, de chasser le matin, d’aller à la pêche l’après-midi, de faire l’élevage le soir et de critiquer après le repas, selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. »
Dès l’Idéologie allemande, Marx refusait la segmentation arbitraire des activités humaines et des rôles auxquels notre condition notamment sociale nous assigne. L’idée selon laquelle l’affirmation et la réalisation de soi passent par une voie unique est radicalement écartée, voire discréditée. Le mouvement qu’appelle et génère le projet communiste ne peut effectivement se contenter de limiter ainsi l’offre des expériences au monde. Or, les logiques capitalistes à l’œuvre dans les « démocraties modernes » valident et acceptent de fait la répartition déterminée sociologiquement du savoir et l’exclusivité des jouissances intellectuelles.
L’art, s’il demeure réduit par une partie des forces réactionnaires à sa dimension purement consumériste et/ou industrielle, doit redevenir pour la gauche le lieu et les occasions par lesquelles tous les individus sont amenés à partager une expérience sensible, indistinctement de leurs capacités initiales. La défense du droit « à éprouver et cultiver le beau » en multipliant les expériences esthétiques n’est jamais un vœu pieu ni une idée abstraite : elle incarne au contraire, à travers les gestes de la pensée et de la création, un attachement ferme à l’accès « à la citoyenneté, la liberté, l’égalité ».
Prôner une véritable démocratie culturelle, c’est revendiquer une société de citoyens épanouis et conscients, tous capables de penser et qui refusent de n’être valorisés ou considérés que sur le plan comptable. La crise économique multiforme que nous vivons s’impose avec la force d’une évidence, mais qu’est-il fait pour prévenir, éviter ou même contenir la « crise culturelle » qui se profile ?
Force est de constater que ce sont les mêmes élites qui jouissent le mieux et le plus durablement de l’offre culturelle et artistique, en qualité et en diversité. Une refondation du rapport de l’art à la société, de l’art au travail, de la politique à l’esthétique… ne peut faire l’économie d’une transformation profonde de cette relation privant de nombreux groupes sociaux (relativement) de toute possibilité d’expression et de manifestation artistiques, excluant ainsi la majorité même du corps social des fruits de cet apprentissage. Or, nous n’entrons pas dans l’art ou en art comme on pousse les portes de son supermarché. La méconnaissance des codes esthétiques, l’ignorance des présupposés et référents historiques, des comportements correspondant à ces savoirs et leur apprivoisement… n’en finissent pas de maintenir bien vivante cette ségrégation culturelle qui sévit sans pousser un cri ni verser une goutte de sang.
Sans les relais institutionnels, associatifs et pédagogiques que représentent l’école, les missions d’éducation populaire, les comités d’entreprise, les ateliers d’initiation… cette promesse n’est rien. Aussi, que ce soit dans l’entreprise, au sein de la famille, dès l’école élémentaire jusqu’aux bancs de l’université… la création – par-delà les considérations et les débats portant sur la formation et la légitimité du jugement du goût – doit être approchée comme un but et/ou une fin en soi, existant pour lui-même et par lui-même. Il apparaît pourtant que les disciplines valorisant ou cultivant la formation et la consolidation de l’esprit critique de jeunes gens en capacité d’observer et de penser le monde à l’abri des discours n’offrant que la rentabilité immédiate pour toute perspective, sont volontairement bafouées ou reléguées au rôle de « supplétif culturel ». Pour lutter contre l’uniformisation de la pensée ou le tri organisé entre savoirs utiles et dispensables, il faut abandonner la croyance selon laquelle un champ de connaissances posséderait un primat sur un autre. Une éducation artistique et une ouverture culturelle véritablement partagées permettront de sortir du schéma de domination sociale persistant élites « savantes » peuple « à cultiver ».
Le moyen le plus sûr et efficace d’offrir à tous les connaissances et pratiques artistiques qu’il transportera (voire transformera) toute sa vie comme à la fois une stimulation de ses potentialités et un éveil de son imaginaire, est que l’école républicaine place chacun devant les mêmes possibles. Entendons par là des invitations concrètes incitant à devenir à la fois spectateur et acteur de la chose artistique comme de l’expérience culturelle.
Si on adhère avec Marx à l’idée selon laquelle « le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous », n’attendons pas, n’attendons plus pour dénoncer et dépasser « la concentration exclusive du talent artistique chez quelques individualités, et corrélativement son écrasement dans la grande masse des gens ».
*Nicolas Dutent est responsable des rubriques Regard, et Mouvement réel de la Revue du Projet. Il est le coordonateur de ce dossier.
La Revue du projet, n° 20, octobre 2012
le 11 October 2012

« Vivant ou mort, Rousseau les inquiétera toujours »
Sur les murs de Genève (2012) , ville où l’on brula (1762) le Contrat social et Emile, deux de ses œuvres majeures
Un auteur, contemporain des préoccupations démocratiques d’aujourd’hui. 300 ans après sa naissance, Jean Jacques Rousseau est un des plus brillants esprits de la période prérévolutionnaire.
Sa dénonciation des inégalités, son appel à une participation de tous au pouvoir souverain, font de Rousseau un penseur progressiste.
Pour débattre de sa modernité, deux spécialistes, un philosophe, Bruno Bernardi, un historien, Claude Mazauric.

le 10 October 2012

En collaboration avec le cinéma "Les lumières" projection « Les parfums de ma terre », un film de Mehdi Lallaoui, en présence de Jacky Malléa, héros du film.
Présentation du livre « L’Humanité censurée -1954-1962- Un quotidien dans la guerre d’Algérie » de Rosa Moussaoui et Alain Ruscio.
Concert musique Arabo-Andalouse par Habibou et Kadem.
Exposition « Marseille-Alger » deux sœurs de la Méditerranée par Mémoires vivantes.
Participation.Tarifs : 8 € (adhérents 6 €).
Comme de tradition chez les Amis de l’Humanité : Sucré-salé apporté par les spectateurs Boisson offerte par l’Association.
Réservation. Pierre PRADEL : pradelpierre@wanadoo.fr.
Sans oublier le « sucré-salé ».